
Dommage qu'il y ait pas mal de petits trucs désagréables dans le film de Thomas Salvador qui m'empêchent d'adhérer pleinement à l'invitation au voyage montagneux, car je sens derrière le geste du cinéaste-acteur une douceur et une sensibilité à la base d'une originalité vraiment attrayante. La Montagne est en ce sens un complément intéressant aux Huit Montagnes de Felix Van Groeningen et Charlotte Vandermeersch, sur un thème voisin mais doté d'un traitement radicalement différent.
Si on devait les énumérer, les maladresses et autres dispositions déplaisantes sont nombreuses. Le contexte posé à la truelle du cadre parisien ingénieur en robotique qui se découvre subitement une attirance pour la montagne lors d'un déplacement à Chamonix, la romance avec Louise Bourgoin (surtout dans la dernière partie affreusement explicative), la métaphore de la renaissance pour clore la partie fantastique du film... Mais étonnamment elles ne parviennent pas vraiment à entacher la sympathie suscitée par le reste, sans doute parce que Thomas Salvador est parvenu à rendre très crédible la découverte d'une passion, en commençant par les tentes 2 secondes Quechua et en allant jusqu'au matos complet de l'alpiniste (Scarpa, Petzl, Millet, cordes, baudar, crampons, piolet, assureur, longes, dégaines, manquent que les coinceurs), même si la transition aurait mérité plus de développement.
Le fait que beaucoup de scènes aient été tournées en altitude, dans le massif du Mont Blanc, aide beaucoup à amplifier l'effet d'immersion. Les bivouacs dans la neige, ça fait frétiller les jambes il faut l'avouer... et ce sentiment une fois perché là-haut de ne pas avoir envie de redescendre, aussi, est pas mal. Il faut adhérer au mutisme du film et de son personnage principal, au moins autant qu'à la composante surnaturelle qui survient dans la seconde partie. Pierre absorbé par la minéralité de la montagne, le message est gros dans la fusion avec les éléments, mais on peut apprécier la position qui ne cherche pas à tout expliquer sans pour autant verser dans le grand n'importe quoi démesurément auteurisant. Le traitement naturaliste de phénomènes surnaturels est intrigant comme démarche, même si je n'accroche vraiment pas à tout le pan figuratif du symbolisme, que je trouve assez lourdingue.













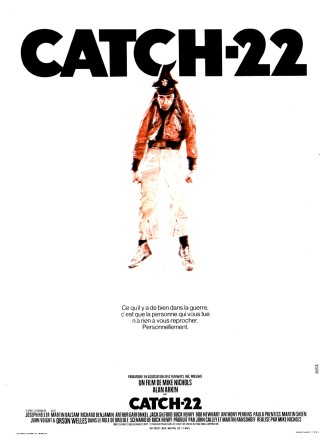
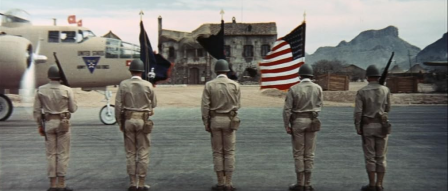











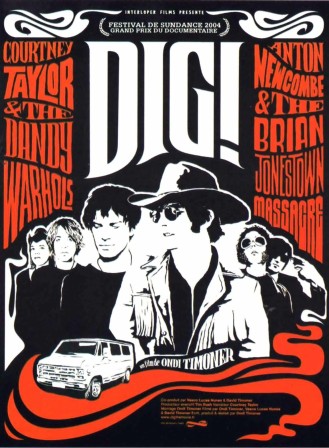











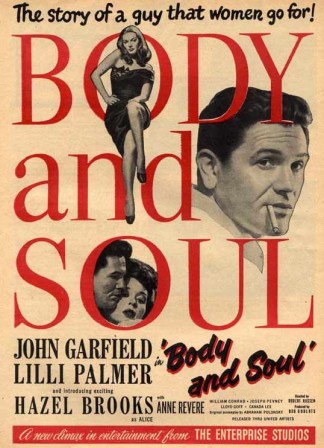















Dernières interactions
Un sujet cousin, ce Madame Hofmann !
15/04/2024, 16:08
https://www.advitamdistribution.com...
13/04/2024, 12:45
Avec grand plaisir. :) (Cheminement intéressant !)
05/04/2024, 10:15
Salut Renaud ! Waouw tu t'es adonné à un sacré travail d'archéologie en…
05/04/2024, 09:49
Travail archéologique #2. :) (qui a l'avantage de me replonger dans certaines…
04/04/2024, 19:47
Salut Nicolas ! Waouw tu t'es adonné à un sacré travail d'archéologie en faisant…
04/04/2024, 19:40