
En matière de cinéma de propagande de guerre, on cite très souvent tout ce que l'industrie hollywoodienne ou le régime soviétique ont pu proposer, dans des sensibilités et des objectifs bien distincts, mais le Japon dispose d'un corpus non-négligeable et même au-delà du passage obligé qui englobe la Seconde Guerre mondiale. Terre et soldats a ainsi été produit dans les années 30, très peu de temps après le conflit (initié en 1931 et terminé en 1945 suite à l'intervention de l'armée russe) en question et sur les vrais champs de bataille de Mandchourie. L'objectif était vraisemblablement de sensibiliser la société japonaise aux conditions de vie des soldats au front en Chine.
Le résultat est assez surprenant, à la fois très simple, très original, et très clivant. Deux heures intégralement consacrées à un compte-rendu immersif de combats depuis le terrain, aux côtés des troupes japonaises, au jour le jour, et parfois même avec l'impression de se dérouler en temps réel. Il n'y a que ça : des soldats qui marchent, qui avancent dans des conditions difficiles, qui tirent et délogent les ennemis de leurs positions défensives. Une vision très singulière, détachée de tout héroïsme individuel et clairement attachée à retranscrire un esprit de groupe, avec des combats succédant aux combats. De temps en temps, une scène de repos fait office de répit : les soldats se reposent, blaguent, lavent la boue de leurs vêtements avant de repartir. De temps en temps, un blessé, mais pas de sang. De temps en temps, un écart à la norme qui pourrait être comique en dehors de tout contexte militaire, avec par exemple un soldat qui s'endort en marchant et qui tombe à l'eau.
Deux heures de combats intenses, donc, alors que l'ennemi sera invariablement invisible. Deux heures d'affrontements mais filmés à une échelle presque microscopique, sans qu'on ne voie la portée de telle ou telle opération : des bunkers sont nettoyés à la grenade, des ouvertures sont créées dans les murs à coups d'armes lourdes, des ponts mobiles sont déployés sous un orage de mitrailleuses, mais il faut attendre presque la fin pour réaliser la réussite de la mission. Pas de tanks, pas de grandes manœuvres, juste des soldats qui avancent lentement dans un style presque documentaire et avec des dialogues extrêmement parcimonieux. Une épreuve assez rude qui prend la forme d'un exercice de style âpre, sec, tendu, et unique en son genre.







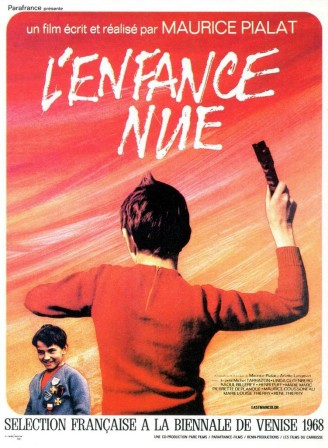
















































Dernières interactions
Un sujet cousin, ce Madame Hofmann !
15/04/2024, 16:08
https://www.advitamdistribution.com...
13/04/2024, 12:45
Avec grand plaisir. :) (Cheminement intéressant !)
05/04/2024, 10:15
Salut Renaud ! Waouw tu t'es adonné à un sacré travail d'archéologie en…
05/04/2024, 09:49
Travail archéologique #2. :) (qui a l'avantage de me replonger dans certaines…
04/04/2024, 19:47
Salut Nicolas ! Waouw tu t'es adonné à un sacré travail d'archéologie en faisant…
04/04/2024, 19:40