
C'est vraiment de l'ordre de la réaction chimique me concernant : il y a dans les films de Tod Browning un mélange d'ingrédients, de thématiques et d'atmosphères qui produit un précipité horrifique vraiment fascinant, détonnant fortement dans le paysage cinématographique des années 1920 et 1930 aux États-Unis. Une originalité d'écriture et un fil rouge en lien avec la transformation des corps qui structurent toute sa filmographie, dont la meilleure illustration est probablement son chef-d'œuvre Freaks, et qui restent encore parfaitement valables et intelligibles aujourd'hui.
Le niveau d'enchâssement des récits est assez remarquable dans The Devil-Doll, son avant-dernier film, produisant une stratification très intéressante des enjeux au fil du déroulement de l'intrigue. Tout commence avec une histoire d'évasion dont on ne maîtrise aucun élément contextuel, ça embraye sur un récit de savant fou qui nous fait part de son invention digne d'un roman de science-fiction portant sur la miniaturisation des êtres vivants (dans le but de résoudre le problème de la faim dans le monde s'il-vous-plaît, avec un petit tacle au passage : "If most men were reduced to the dimensions of their mentality, Marcel's plan wouldn't be necessary"), puis une histoire de vengeance particulièrement machiavélique se met en branle avant de terminer sur un climax émotionnel sous la forme d'une conclusion digne des plus beaux mélodrames de l'époque — on reconnaît là sans doute l'intervention de Erich von Stroheim qui a participé à l’écriture du scénario. Excusez du peu. Tout ces points pourraient concourir à l'élaboration d'un pot-pourri informe et indigeste, mais à l'opposé, participent à la confection d'une toile narrative dense, envoûtante, grotesque juste comme il faut, et d'une très convaincante efficacité.
Si l'on n'avait pas peur des analogies un peu excessives, on pourrait trouver une anticipation du classique de Jack Arnold L'Homme qui rétrécit (The Incredible Shrinking Man) qui ne sortira que 20 ans plus tard en 1957 — dans des considérations horrifiques très différentes — avec un soupçon de malice des jouets de Small Soldiers (1998) animées par Joe Dante. La qualité des effets spéciaux permet de rendre le fiction encore prenante vue de 2023, avec pour créer l'effet de changement d'échelle d'un côté des surimpressions évidentes qui bavent un peu et de l'autre côté des décors gigantesques construits pour l'occasion. Le résultat est d'une fluidité que je trouve franchement bluffante, et ce d'autant plus que cela s'inscrit dans des passages typés thriller conférant aux êtres miniaturisés un pouvoir de mort.
En marge de ces scénarios riches en points de singularité et en personnages déviants, Tod Browning apparaît à mon sens comme un précurseur très lointain de David Cronenberg avec qui il partage une lubie très particulière, la transformation des corps et leur caractère très photogénique. Aucune trace de la "nouvelle chair" ici bien sûr, ici il est systématiquement question de divers registres de criminalité brouillant sans cesse la frontière entre ceux qu'on considère comme vertueux et ceux qu'on traite comme malfrats. Browning aura toujours manifesté un attrait pour la difformité et pour le déguisement, en les mêlant à des histoires sombres de meurtres et de mensonges. Et dans ce rôle, Lionel Barrymore livre une prestation particulièrement réussie, dans la veine de ce que pouvait produire Lon Chaney — la transformation de Barrymore en petite vieille fabriquant des poupées rappelle d'ailleurs très fortement le rôle de Chaney dans The Unholy Three. Un support très approprié pour ces personnages qui arborent un physique décalé et qui alimentent une atmosphère étrange dans un maelstrom de sentiments contrastés.
Et il fallait quelqu'un de solide pour incarner la vengeance ce cet homme, un ancien banquier envoyé en prison par ses trois anciens associés ayant comploté contre lui... Car on ne parle pas de n'importe quelle vengeance, on entre presque dans le registre des malfaiteurs dans Les Vampires de Louis Feuillade, c'est tout de même quelqu'un qui va transformer le premier en Lilliputien, pour ensuite utiliser une de ces créatures comme d'une poupée Chucky pour s'immiscer chez le second et lui administrer un poison paralysant, avant de se concentrer sur le troisième, exposer le complot et lui faire avouer des méfaits vieux de 17 ans. Par cet acte, Barrymore s'innocente aux yeux de la société tout en se condamnant à nouveau (il a commis quelques actes quand même un peu répréhensibles dans le processus), mais il aura réparé le lien qui s'était rompu avec sa fille, pleine de rancœur, elle qui l'accablait de tous les maux depuis son enfance ("You're very young to be so bitter" lui dira-t-il, sous son déguisement). On l'aurait presque oublié, mais cet homme qui fomente une vengeance complètement dingue (personnage en ce sens typique du cinéma de Browning, un de ces "gentils" ou considérés comme tels qui ont recours au mode d'action des "méchants") sous les traits et les habits d'une grand-mère inoffensive, agissait avant tout pour laver son honneur et retrouver une respectabilité aux yeux de sa fille. Elle le comprendra aisément, elle qui travaillait le jour dans une blanchisserie mais contrainte à la saleté d'une brasserie comme serveuse de nuit. Au sommet de la Tour Eiffel, au creux d'un instant de pureté loin de la crasse des bas-fonds parisiens, il se réconcilie avec elle et choisit l'unique option : une ultime disparition.







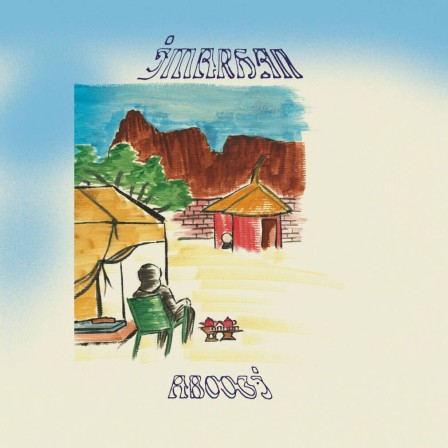














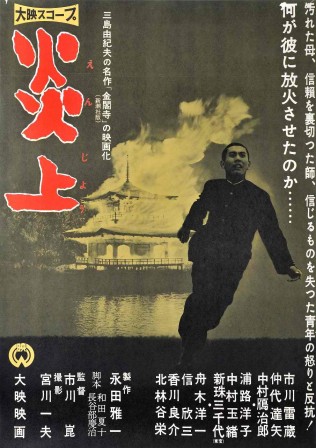











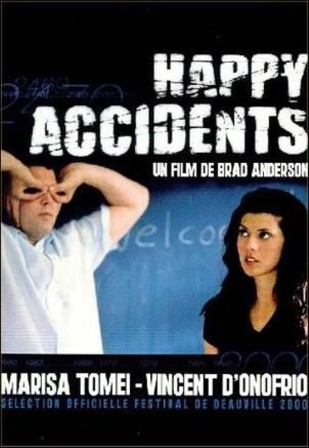


















Dernières interactions
Un sujet cousin, ce Madame Hofmann !
15/04/2024, 16:08
https://www.advitamdistribution.com...
13/04/2024, 12:45
Avec grand plaisir. :) (Cheminement intéressant !)
05/04/2024, 10:15
Salut Renaud ! Waouw tu t'es adonné à un sacré travail d'archéologie en…
05/04/2024, 09:49
Travail archéologique #2. :) (qui a l'avantage de me replonger dans certaines…
04/04/2024, 19:47
Salut Nicolas ! Waouw tu t'es adonné à un sacré travail d'archéologie en faisant…
04/04/2024, 19:40