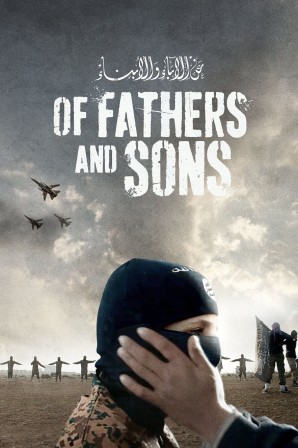
Toutes les cases du documentaire d'exception sont cochées : sujet en or, immersion absolue, travail de préparation conséquent, suivi au très long cours, peu de commentaires externes, et surtout, probablement le plus important sur des thématiques aussi extrêmes, une neutralité sans faille dans la captation du phénomène observé. Une question finalement assez simple que l'on peut se poser systématiquement à l'issue de visionnages de cet ordre pour en évaluer la pertinence de la retranscription : que penseraient du contenu les personnes filmées ou des personnes ayant des points de vue opposées vis-à-vis de la thématique ? J'ai l'intime conviction que tous les partis n'auraient rien à redire concernant les faits exposés dans Of Fathers and Sons, et c'est à mes yeux la marque d'un documentaire a minima digne de respect.
Cela étant posé dans un cadre le plus abstrait qui soit, il faut quand même maintenant aborder le vif du sujet, annoncé de manière très explicite par le titre français. Talal Derki, réalisateur kurde syrien exilé en Allemagne, est parvenu à retourner dans sa Syrie natale, gagner la confiance d'une famille de djihadistes salafistes (grâce à ses contacts et amis photographes locaux) appartenant au Front al-Nosra, et partager leur quotidien sur une durée proprement hallucinante, 330 jours répartis sur un peu plus de trois années après avoir pris le soin d'effacer son identité sur internet pour assurer sa sécurité. Il faut vraiment voir l'ampleur de l'horreur pour réaliser le danger d'une telle captation documentaire : c'est un univers dans lequel des gamins de même pas dix ans apprennent à caillasser les filles ne portant pas le hijab (avec l'assentiment enjoué des pères), à manipuler pistolets et AK-47, et à jouer en fabriquant de fausses mines antipersonnel (l'équivalent local et plus risqué du coca + mentos disons, où l'on peut perdre une jambe dans la manœuvre). Un monde désolé, délabré, uniquement fait de terrains vagues et d'habitations primaires, où l'on va tirer au sniper sur des infidèles pour s'amuser avec les copains un peu comme on jouerait aux jeux-vidéo. C'est presque banal, parfaitement naturel, et par contre glaçant au plus haut point.
À noter que Talal Derki a décidé de ne plus retourner en Syrie dans le cadre de ce projet le jour où il a appris qu'un djihadiste tunisien très dangereux cherchait à le rencontrer : deux mois plus tard, il se faisait tatouer le bras et percer une oreille pour sceller définitivement l'impossibilité de revenir auprès des fous furieux de dieu.
Les présentations avec la petite vie de famille seront des plus irréelles, à commencer par les noms donnés à la fratrie, choisi en hommage aux terroristes du 11 septembre 2001. L'une des premières séquences nous montre les gentils gamins du patriarche Abou Oussama jouer avec un joli petit moineau, "attention ne serre pas trop tu vas lui faire mal", c'est tout mignon. Une minute plus tard, le gamin revient : "Papa j'ai égorgé l'oiseau", ce à quoi il répond, tout guilleret, "Bon, c'est mieux ainsi que s'il était mort en jouant avec", et le frère de l'apprenti-bourreau âgé de 7-8 ans précisant "Oui papa, il l'a tué après lui avoir fait pencher la tête en avant, comme toi avec cet homme [que tu as décapité l'autre jour, entre le repas et la sieste, en substance]". Après quelques paroles dignes d'un cas psychiatrique aigu voyant la volonté de dieu derrière chaque caillou et chaque mise à mort, le paternel conclut avec sagesse : "il ne faut pas enfermer les oiseaux dans des cages. Si tu en vois un prisonnier, libère-le". Confusion au maximum.
Effroi total évidemment, dès lors que la référence à un acte sauvage extrême sort de la bouche de cet enfant même pas en âge de connaître ses tables de multiplication. Cette séquence un peu matricielle contient la structure qui fait toute la puissance de Djihadistes de père en fils (la distribution française s'est sentie obligée de rajouter une couche inutile dans le titre), à savoir cette alternance troublante, insoutenable et littéralement incroyable de moments abominables et de moments tendres. Des mômes qui jouent et qui se chamaillent comme dans n'importe quelle cour de récré, et juste après, qui vont balancer des gros cailloux sur les filles de leur âge sortant de l'école (dont ils ont été retirés par le père à cause de la mixité). Des moments poétiques où l'on voit des enfants lancer des ballons en l'air, propulsé par l'air chaud d'une flamme en leur centre, et des séquences d'endoctrinement théologique et militaire où les bambins sont en treillis, cagoulés, et subissent le plus brutal des lavages de cerveau. On égorge un bouc en famille en suivant un précepte religieux lambda, et on construit une piscine improvisée pour que les garçons puissent y jouer comme n'importe quels autres. Bref, un père aimant et une fratrie de 8 garçons (qui nourrissent un ennui profond), si l'on faisait abstraction de tout le reste — à commencer par l'absence radicale de femmes dans le champ de la caméra, l’agressivité omniprésente dans les rapports humains et le non-sens permanent des discours.
Tout le documentaire est concentré dans cette horreur double, cette transmission familiale pétrifiante, tandis qu'on assiste à la destruction de l'innocence des enfants ainsi qu'à la formation de futurs tueurs de métier dans le même mouvement. Le docu est particulièrement riche et diversifié en marge de cet aspect central, comme par exemple ce rapport à la mort et au martyr sur le thème "Pour chaque enfant tué, mille autres renaîtront" ressassé par le patriarche, ou encore ce groupe de jeunes soldats capturés dans les rangs de l'armée régulière, humiliés, dont le sort funeste ne laisse guère de doute. Ou encore le quotidien de Abou Oussama, sniper et démineur, tandis qu'il travaille au déminage d'un terrain accidenté. On le retrouvera quelques scènes plus tard, sonné, allongé sur un lit, le visage abîmé par de grosses balafres, les yeux et les mains égratignés... amputé du pied gauche suite à l'explosion d'une mine, heureux que ça ne soit pas tombé sur le droit. Il se tuera accidentellement en 2018 en retirant une bombe d'une voiture piégée, apprend-on en dehors du docu. Et avec en conclusion un micro-message d'espoir : si l'un des enfants est envoyé au combat à la fin du film, un autre retourne à l'école.




























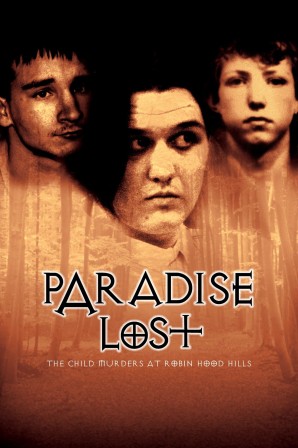





































Dernières interactions
Un sujet cousin, ce Madame Hofmann !
15/04/2024, 16:08
https://www.advitamdistribution.com...
13/04/2024, 12:45
Avec grand plaisir. :) (Cheminement intéressant !)
05/04/2024, 10:15
Salut Renaud ! Waouw tu t'es adonné à un sacré travail d'archéologie en…
05/04/2024, 09:49
Travail archéologique #2. :) (qui a l'avantage de me replonger dans certaines…
04/04/2024, 19:47
Salut Nicolas ! Waouw tu t'es adonné à un sacré travail d'archéologie en faisant…
04/04/2024, 19:40