
That's just the way, isn't it? You don't want trouble but sometimes trouble wants you.
Encensée pour son premier film long format, l'horrifique et oppressant Mister Babadook, l'Australienne Jennifer Kent était attendue au tournant pour sa deuxième réalisation. Elle choisit de changer de genre, et surtout de cadre, en livrant un récit de poursuite vengeresse et une plongée dans la Tasmanie du XIXème siècle. A cette époque, l'île océanienne était considérée comme un "enfer sur Terre" car, outre le fait que les soldats de l'Empire Britannique y massacrait les autochtones aborigènes au cours de la Black War, elle s'apparentait à une prison à ciel ouvert. Le Royaume de la Reine Victoria y exilait des criminels chevronnés et, pour rééquilibrer un peu la balance des genres, quelques femmes condamnées pour des délits mineurs. Parmi ceux-là, parmi celles-ci, "the scum of the Earth" d'après les Anglais : des Irlandais.
L'héroïne du film, Clare, vient de l'île d'Éire. Les actes qui lui valurent un voyage sans retour aux antipodes ne seront pas révélés. Ce qui importe, c'est qu'ils l'ont rendue à une condition de quasi-esclavage auprès du capitaine du régiment local. Elle a bien sa propre demeure et a obtenu le droit d'épouser un compatriote, avec qui elle vient d'avoir un enfant, mais dans l'auberge où elle travaille, elle est tenu d'obéir, au doigt et à l'œil, à l'officier. Ce dernier, qui détient le pouvoir de l'affranchir d'une lettre (à laquelle elle a déjà droit depuis plusieurs mois, ayant purgé sa peine), l'exhibe parfois dans des tours de chant : sa voix harmonieuse rappelle le rossignol qui donne son titre au film. Un soir, dans l'intimité de sa chambre, il exige plus. Comme elle s'y refuse, il la force et la viole. De là, les évènements prendront une tournure encore plus tragique, encore plus brutale, et alors que l'officier doit se rendre au plus vite de l'autre côté de l'île, en coupant à travers la forêt à la suite d'un guide local, elle se lancera à sa poursuite, avide de vengeance.
Le viol est un des motifs du film, ce qui résonne aujourd'hui et est un crime qui hélas devait être très répandu dans la Tasmanie de l'époque, où pour une détenue exilée on comptait huit hommes. Un motif qui vaut au film d'être souvent qualifié de "rape and revenge", sous-genre du cinéma d'exploitation. C'est à mon sens une erreur - une facilité de critique ou de reviewer - car le viol n'est pas ici l'acte qui induit la vengeance. Ce motif, associé à d'autres aussi violents, valut au film un accueil mouvementé lors de sa première à Sydney (quelques spectateurs, et spectatrices, quittèrent la salle) puis par une certaine presse/internet anglo-saxonne. La projection au Festival de Venise, d'où le film repartit avec deux prix, fut également houleuse : une poignée d'abrutis se rendirent coupables de réactions sexistes et racistes (ce qui, à mon avis, dit quelque chose du climat de l'Italie de Giorgia Meloni, où le salut fasciste revient à la mode).
Pour les diffuseurs, le film souffre d'être difficilement cataloguable. La jaquette du Dvd, illustrée d'une image de l'héroïne chargeant, arme en mains, devant l'Union Jack en flammes, est trompeuse ; loin d'enchaîner les scènes d'action, le film sait prendre son temps et emplir ses deux heures quinze de différentes tonalités.
Ainsi, pendant que l'héroïne s'aventure dans la forêt australe, le récit développe, nécessairement, ses relations avec le jeune aborigène qu'elle paye pour la guider. De prime abord, Clare n'a guère de considération pour lui (qu'elle voit comme simple moyen pour arriver à ses fins), ni lui pour elle. Leurs rapports évolueront, passant par des hauts et des bas, jamais statiques. Une illustration : qui débute sur une dispute et s'achève sur un moment de grâce (comme son patronyme ne l'indique pas, l'actrice Aisling Franciosi est irlandaise et connaît bien les chansons traditionnelles, telle qu'ici "Óró 'Sé do bheatha 'bhaile").
Chasseurs et chassés, dans leur périple, traversent des paysages d'une beauté sauvage, mais la mise en scène ne s'y attarde pas. A juste titre, car le temps presse et la soif de vengeance, dévorante, ne laisse pas de place à l'émerveillement. La vengeance par mise à mort, motif narratif classique et puissant, est à mon sens trop souvent traité dans les films de manière simpliste et héroïque. Non qu'il ne me plaise pas de voir un salopard de cinéma recevoir son dû (et quelle ordure compose Sam Claflin, acteur jusqu'alors plutôt tenu aux rôles romantiques !), mais j'apprécie toujours que soient présentés les revers de l'acte de vengeance: insatisfaction, injustice, cercle de la violence, etc. Jennifer Kent n'esquive pas ces problématiques et je lui en sais gré.
Au final, si The Nightingale ne me paraît pas totalement abouti (sur le plan du rythme, par exemple, où l'on peut trouver quelques longueurs et redondances), il demeure une œuvre cinématographique âpre et un deuxième étape prometteuse du parcours de sa réalisatrice.
Quelles seront les suivantes ? Difficile à dire.
Après un détour par l'anthologie fantastique de Guillermo Del Toro (Le cabinet de curiosités) avec l'épisode Murmuration, une histoire de fantômes, elle fût attachée à plusieurs projets : une cavale meurtrière de deux amoureuses dans l'Amérique du XIXème siècle, une série d'horreur surnaturelle dans l'Irlande du XVIIIème, ou encore l'adaptation d'un roman pour la jeunesse de Clive Barker... Mais rien de concret jusqu'alors. "Wait and see."




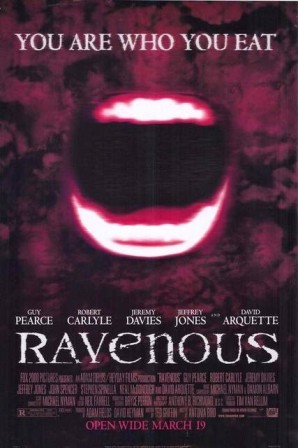
















Dernières interactions
Ah je serais très heureux d'avoir ton avis là-dessus ! C'est mon gros coup de…
24/06/2025, 11:54
Merci pour cette chronique sensiblement enthousiaste. Il est fort parfois le…
24/06/2025, 10:49
Ouch ou encore Civil war d’Alex Garland (2024)
12/06/2025, 16:03
Décidément, on se rapproche de l'introduction d'un prochain volet d'American…
12/06/2025, 10:19
Ah je trouve La Jetée beaucoup plus immédiatement appréciable que The Stalker…
09/06/2025, 11:21
Je suis mauvais élève, je n’ai pas vu le film. Mais j’ai ouï dire que le sens de…
08/06/2025, 22:50