"The evil American husband standing in the way of destiny."
Past Lives n'est certainement pas le premier film sur le thème des histoires d'amour contrariées, impossibles sous certains aspects, jouant la carte de la mélancolie existentielle avec force. Mais c'est un premier film étonnant de maîtrise et de mesure. Évidemment il y a dans le geste de Celine Song un potentiel hautement clivant puisque il s'agit d'un cinéma très allusif, travaillant presque exclusivement la veine de la suggestion, du genre où "il ne se passe rien" pour peu qu'on ne soit pas pris dans le tourbillon des sentiments qui sont évoqués — alors que dans le cas contraire, ce sera l'exact inverse au travers des nombreuses dimensions des tourments sentimentaux esquissés ici et qui pourront entrer en résonance avec ceux qu'on a tous vécus dans notre vie. Il y a très clairement une orientation minimaliste dans cette romance impossible, et Song utilisera de nombreux leviers pour produire ces effets de litote, au sens où les dialogues sont à 90% basés sur des conversations anodines en apparence et où les non-dits structurent l'essentiel des communications. Le procédé peut agacer, il pourrait même laisser de marbre, on peut le concevoir assez facilement : en revanche, il peut également emporter tout sur son passage et exprimer un puissant déchirement au travers de simples souvenirs et de simples regrets.
L'ellipse est probablement l'artifice le plus évident dans le film : Song nous rend intelligible la situation réunissant Nora et Hae Sung (Greta Lee et Yoo Teo, tous deux excellents dans leurs rôles respectifs) à l'aide d'un découpage net en trois temporalités. 1) L'enfance, leur relation d'amour platonique, leurs angoisses à l'idée d'être séparés suite à l'annonce du projet d'émigration au Canada par la famille de Nora ; 2) la fin de l'adolescence, une dizaine d'années plus tard, où les deux se retrouvent sur Internet un peu par hasard, à la faveur d'une brève reconnexion ; 3) l'âge adulte, qui sera celui des retrouvailles à New York, mais aussi celui du bilan. Spoiler : tout ne sera pas facile.
Sans surprise, l'inventaire des ressentis se fera dans la douleur. Il n'est pas forcément nécessaire de recourir au concept du "fil du destin" (inyeon) au cœur du film, un terme sud-coréen intraduisible renvoyant aux liens et aux connexions émotionnelles qui unissent deux personnes. La romance malmenée aborde de nombreuses thématiques qui se suffisent à elles-mêmes, indépendamment de cette grille de lecture, d'une part du côté du déracinement subi (émigration, séparation, choix des parents qui s'imposent aux enfants, reconstruction d'un tissu social dans un autre pays), et d'autre part du côté des occasions romantiques manquées (avec tout ce que l'on peut imaginer en termes de conjectures sentimentales, à partir d'un début de relation brisé et des scénarios qui auraient pu défiler si les circonstances avaient été différentes). Song tisse sa mise en scène dans une forme d'épure efficace, très précise, élaborée tout en restant pragmatique — ce qui est notable pour une première réalisation, très bien équilibrée entre sobriété et exaltation — et parvient très bien à faire communiquer (à faire se confronter serait plus juste) les aspirations de l'enfance alimentées par une forme d'idéalisme naïf avec la dure loi de l'univers adulte, ses contraintes, ses marges de manœuvre réduites, son champ des possibles limité.
Past Lives emprunte ses thématiques à une large collection de films (Minari pour le déracinement d'une famille coréenne, In the Mood for Love pour l'évolution contrariée de rapports intimes, Before Sunrise pour la notion du temps compté pour vivre un moment privilégié) mais parvient malgré tout à préserver une grande originalité dans la formulation de la synthèse, traitant autant des rapports amoureux que des effets du temps. De prime abord le personnage secondaire du mari de Nora (John Magaro) peut paraître assez faible comparé aux deux autres, mais il se fait in fine le témoin impuissant de cette relation tardive ("In the story, I would be the evil white American husband standing in the way of destiny" dira-t-il avec beaucoup de lucidité) dont il peine à saisir les contours (et pour cause : sa femme aussi), qui envahit soudainement sa vie, mais qu'il accepte pour permettre à sa femme de faire le deuil de son ancien et premier amour (ce qu'il espère, en tout état de cause). Par son biais les deux composantes qui façonnent la personnalité de Nora, mi-Coréenne mi-États-unienne, entrent presque en conflit, comme deux parties qui n'avaient jamais réellement communiqué (encore une fois, son mari explicitera cela : "You dream in a language that I can't understand, it's like there's this whole place inside of you where I can't go"), deux parties que personne n'appréhendera jamais véritablement de manière simultanée.
Il y a donc bien une fascination pour le vide dans Past Lives, mais le vide consubstantiel aux regrets des actions que l'on n'a pas entreprises, à la cruauté des souvenirs qui blessent quand ils sont confrontés à la réalité — Hae Sung l'évoquera à Nora, "I didn't know that liking your husband would hurt this much". Amer constat qui n'aidera pas beaucoup à cicatriser les plaies, et magnifié par le plan final, entrecoupé par deux travellings latéraux somptueux, dans lequel les deux protagonistes échangent difficilement leurs derniers mots.








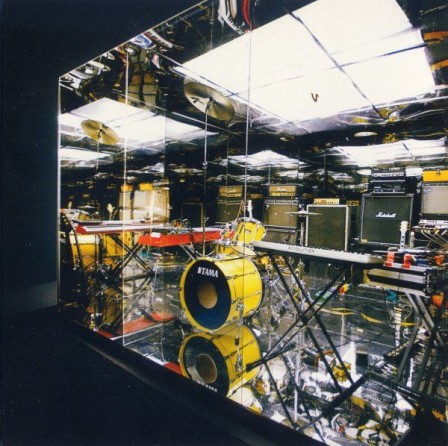
































































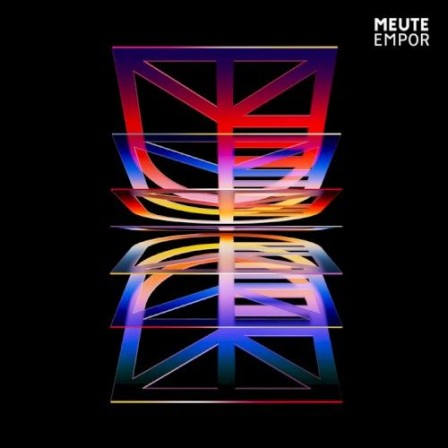




Dernières interactions
Ah je serais très heureux d'avoir ton avis là-dessus ! C'est mon gros coup de…
24/06/2025, 11:54
Merci pour cette chronique sensiblement enthousiaste. Il est fort parfois le…
24/06/2025, 10:49
Ouch ou encore Civil war d’Alex Garland (2024)
12/06/2025, 16:03
Décidément, on se rapproche de l'introduction d'un prochain volet d'American…
12/06/2025, 10:19
Ah je trouve La Jetée beaucoup plus immédiatement appréciable que The Stalker…
09/06/2025, 11:21
Je suis mauvais élève, je n’ai pas vu le film. Mais j’ai ouï dire que le sens de…
08/06/2025, 22:50