
Jack Nicholson n'a pas été le réalisateur de beaucoup de films (IMDb en compte quatre, dont un non-crédité) et à la différence de The Two Jakes qui sera formellement beaucoup plus maîtrisé 12 ans plus tard, Goin' South est assez amusant dans son côté bordélique et loufoque qui semble totalement assumé par son cinéaste-acteur. Enfin, "amusant", c'est un bien grand mot, au sens où le niveau de cabotinage est assez élevé, Nicholson n'hésitant pas à se mettre très fréquemment au centre du plan avec des grosses grimaces derrière sa face hirsute. Mais là où cette sensation de grotesque ou d'approximatif pourrait faire fuir beaucoup de gens, bizarrement, elle a suscité chez moi beaucoup de sympathie.
Une bonne part de cette réception heureuse tient à mes yeux au duo improbable formé par Jack Nicholson d'une part, un voleur de chevaux excentrique promis à la pendaison au lendemain de la guerre de Sécession, et Mary Steenburgen d'autre part, en contraste total dans sa retenue et dans son calme, et accessoirement propriétaire terrienne qui le sauvera de la potence en l'épousant in extremis — eh oui, à l'époque, les campagnes étant dépeuplées de mâles pour cause d'hécatombe récente, une loi autorisait ce genre d'accord, sous réserve que l'homme se conforme aux attentes de la femme : en l'occurrence, il faudra charbonner au fond d'une mine pour tenter d'en extraire un bien hypothétique or, mais aussi à la maison pour aider madame à sortir de sa frigidité acquise depuis longtemps, l'humour latent provenant de cette comédie romantique sortant un peu de nulle-part dans ce décor de western.
C'est tout à fait improbable mais le jeu excessif de Nicholson fonctionne, le condamné à mort tout juste sauvé semble avoir pété une durite, empêtré dans des soucis domestiques, mené à la baguette. Aux côtés de Mary Steenburgen, la coïncidence (qui n'en est peut-être pas vraiment une) la fait rencontrer dans ce film Christopher Lloyd 12 années avant leur idylle dans le troisième volet de Retour vers le futur, et dans la toile de fond agréable des personnages secondaires remontent régulièrement John Belushi, Veronica Cartwright et Danny DeVito. La ligne d'équilibre trouvée entre la parodie de western et la comédie romantique est agréable dans le burlesque qu'elle travaille (avec de nombreuses petites vignettes stupides), et la maladresse de l'ensemble ne fait que renforcer sa dimension attachante.























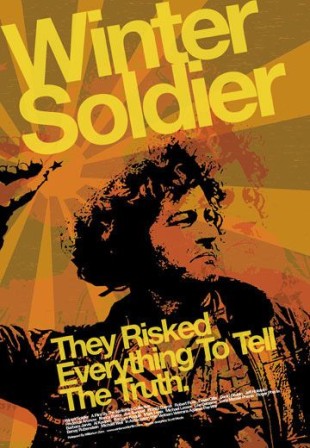






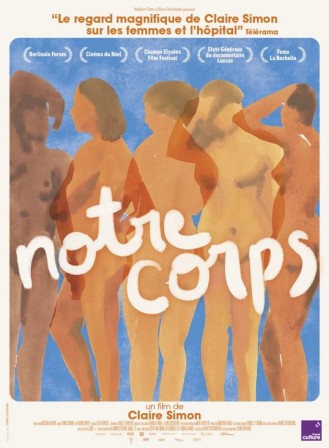






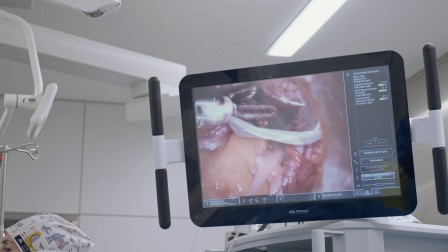











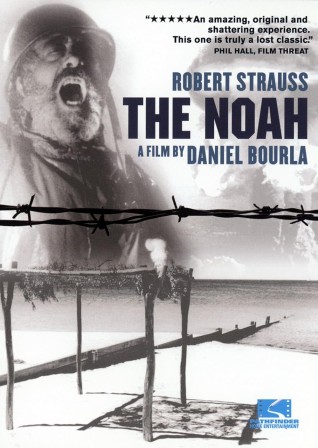


















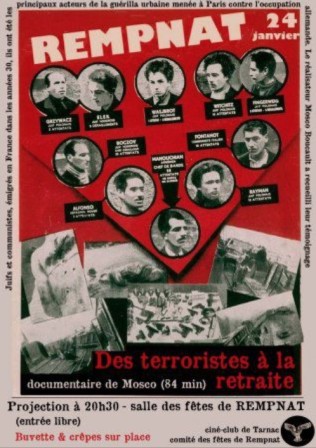










Dernières interactions
Un sujet cousin, ce Madame Hofmann !
15/04/2024, 16:08
https://www.advitamdistribution.com...
13/04/2024, 12:45
Avec grand plaisir. :) (Cheminement intéressant !)
05/04/2024, 10:15
Salut Renaud ! Waouw tu t'es adonné à un sacré travail d'archéologie en…
05/04/2024, 09:49
Travail archéologique #2. :) (qui a l'avantage de me replonger dans certaines…
04/04/2024, 19:47
Salut Nicolas ! Waouw tu t'es adonné à un sacré travail d'archéologie en faisant…
04/04/2024, 19:40