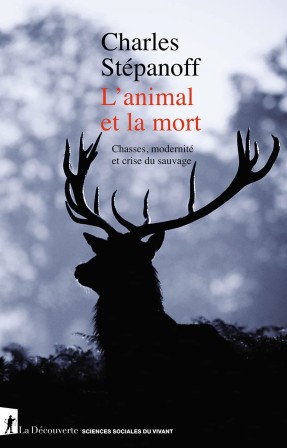
À l'origine de L'Animal et la mort, il y a chez l'ethnologue Charles Stépanoff par ailleurs spécialiste de la Sibérie (et de ses chamans) la volonté de comprendre l'origine d'un hiatus omniprésent dans les sociétés modernes, et de multiples paradoxes afférents. La confrontation ne se limite pas aux considérations banales de pro- et d'anti-chasse que l'on entend partout et tout le temps, et l'analyse creuse avec une profondeur assez renversante le rapport contrasté (hypocrite, aveugle, antipodique, etc.) que l'on entretient avec les animaux. Il introduit le principe d'exploitection, c'est-à-dire la co-existence de deux concepts fondamentalement antinomiques que sont l'extrême sensibilité (protection des animaux) et l'extrême insensibilité (exploitation des animaux) dans un cadre cosmologique.
On peut comprendre que Stépanoff, dans son argumentaire comme dans son enquête de terrain, accorde une place infiniment plus importante à la sociologie de la chasse pour mieux en comprendre les fondements et les rapports, plutôt qu'à la vision opposée largement exposée médiatiquement — pas toujours sous un angle constructif. Cela en fait un bouquin vraiment passionnant pour décortiquer ce rapport schizophrénique que l'on entretient généralement à l'animal : il y a les animaux-enfants, nos animaux de compagnie que l'on chérit plus que tout, et les animaux-matière, ceux qui finissent en barquette plastique dans des rayons de supermarché, et dont la mise à mort est dissimulée, institutionnellement occultée.
Cette immersion anthropologique dans le monde de la chasse est très intéressante également du point de vue des témoignages, des reportages dans différentes communautés de chasseurs (de différents types, battues, chasses à courre, etc.). Certains parallèles établis avec le chamanisme sibérien ne paraissent pas toujours justifiés — pas tangibles du moins — et clairement l'opposition entre chasseurs et militants n'est pas à la hauteur du reste de l'ouvrage. J'y ai ressenti beaucoup d'angles morts et une forte asymétrie dans la profondeur de la caractérisation. Disons que malgré une certaine neutralité et une distance au sujet évidente, le fait que le contenu puisse être exploité pour légitimer certaines pratiques me met assez mal à l'aise, comme s'il manquait une perspective complémentaire essentielle. Ce sont en tous cas les chapitres qui m'ont le plus rebuté dans leur longueur un peu excessive.
Mais très clairement Stépanoff pointe avec élégance et profondeur une contradiction historique entre sensibilité protectrice et économie productiviste, qu'il date principalement depuis la Renaissance. Sa considération pour la chasse comme une altérité résistant à monde domestiqué et artificialisé ne manque pas de titiller certaines convictions, même si l'espace est exigu dans la région définie par les chasseurs ruraux authentiques et la préservation de la ressource sauvage. À mes yeux la chasse comme pratique consciente de protection de la nature n'est pas établie dans le bouquin, pas plus que la compassion pour leurs proies n'est démontrée (objectivement j'entends, car les témoignages personnels affirmant cela abondent, ce qui est très intéressant). Comme si Stépanoff n’avait pas décodé une partie codée du message. En revanche il met le doigt sur quelque chose de fondamental, l'éthique de ceux qui tuent pour se nourrir et la relégation dans l'invisible de l'exploitation (animale, agricole, etc.) véhiculée par la consommation de matière carnée industrielle.
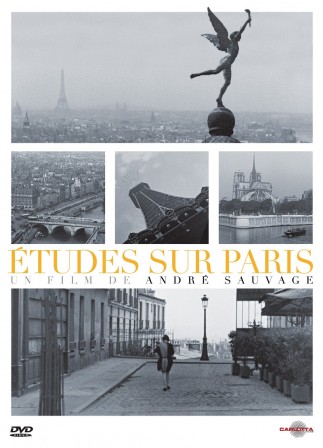







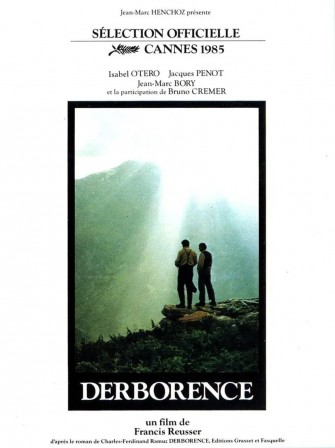




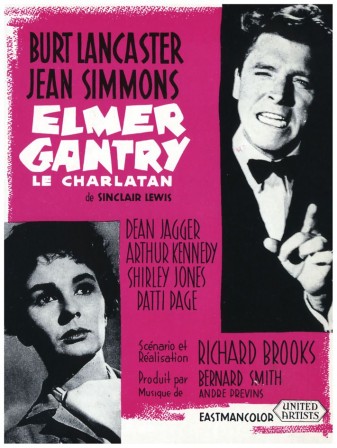







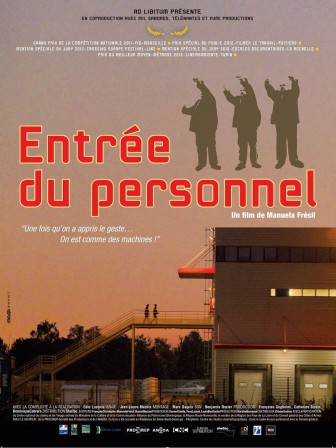













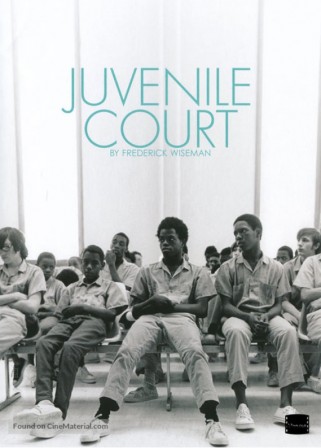










Dernières interactions
Un sujet cousin, ce Madame Hofmann !
15/04/2024, 16:08
https://www.advitamdistribution.com...
13/04/2024, 12:45
Avec grand plaisir. :) (Cheminement intéressant !)
05/04/2024, 10:15
Salut Renaud ! Waouw tu t'es adonné à un sacré travail d'archéologie en…
05/04/2024, 09:49
Travail archéologique #2. :) (qui a l'avantage de me replonger dans certaines…
04/04/2024, 19:47
Salut Nicolas ! Waouw tu t'es adonné à un sacré travail d'archéologie en faisant…
04/04/2024, 19:40