Bien qu'il apparaisse dans la période tardive du film noir, Plunder Road (en version originale) ressemble à une sorte de définition matricielle du genre. Tous les ingrédients sont là, dans un format essoré au maximum pour n'en laisser que le strict minimum nécessaire. Il n'y a de place que pour l'essentiel et rien d'autre : pas de contexte, pas de description psychologique, pas de gras. Deux parties bien disjointes composent l'intrigue : une première, plus courte, traite du pillage éponyme à proprement parler. Pas n'importe quel braquage : celui d'un train transportant des tonnes d'or. Dans la grande tradition du film noir laconique, il n'y aura quasiment aucune ligne de dialogue pendant cette séquence, et c'est dans un silence pluvieux et coordonné que les cinq hommes effectuent leur besogne. Puis, dans la seconde partie, c'est un triple road movie sous tension, avec le groupe s'étant divisé en trois camions (avec leurs couvertures respectives : déménagement, café, et produit chimique) et trois tiers de magot pour maximiser les chances de succès dans la fuite.
Tout le programme est là. Hold-Up, aussi connu sous la dénomination "Les Pillards de la route", ne contient aucune véritable surprise, et à ce titre ne décevra pas pour peu qu'on s'y soit rendu en connaissance de cause. Un film noir pur à destination des amateurs — les autres finiront aussi exaspérés qu'un non-amateur de western tradi devant un John Ford. Mais Hubert Cornfield encapsule le scénario sec qu'on lui a confié dans une certaine élégance de mise en scène pour conférer une tension efficace, nocturne et vive, à la scène de casse et une tension plus diffuse lorsque tous les flics de la région se mettront à la recherche des 10 millions de dollars disparus. On aura même droit à une séquence de fonderie pour transformer l'or en pare-chocs et en enjoliveurs... Si l'on n'est pas trop regardant sur les bévues prévisibles et les seconds rôles particulièrement rigides, et si la morale très classique servie en mode automatique ne gêne pas trop, alors la série B se fera tranchante et captivante.
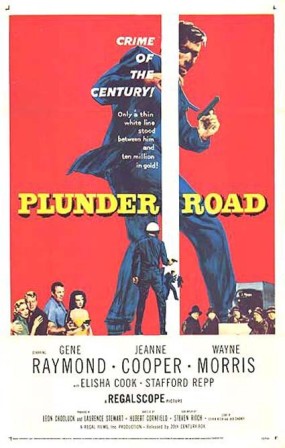














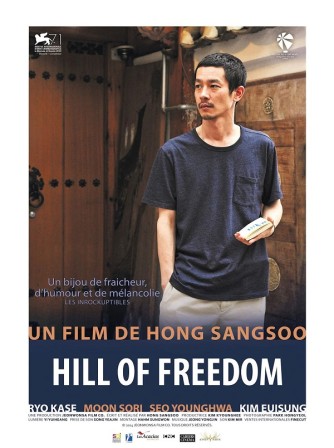





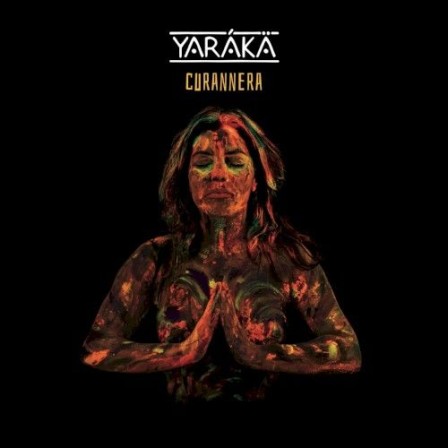
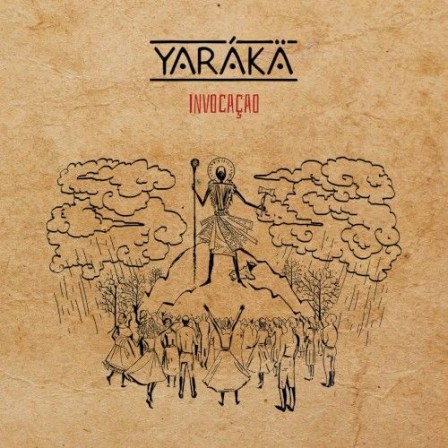




















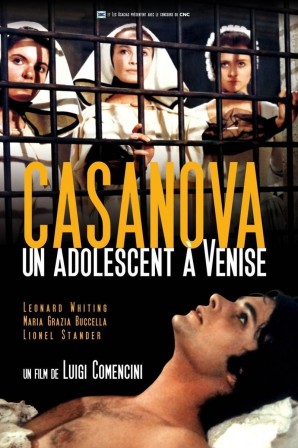





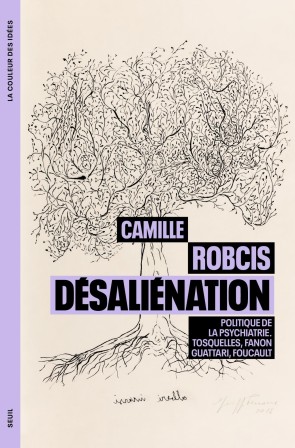






Dernières interactions
Ah je serais très heureux d'avoir ton avis là-dessus ! C'est mon gros coup de…
24/06/2025, 11:54
Merci pour cette chronique sensiblement enthousiaste. Il est fort parfois le…
24/06/2025, 10:49
Ouch ou encore Civil war d’Alex Garland (2024)
12/06/2025, 16:03
Décidément, on se rapproche de l'introduction d'un prochain volet d'American…
12/06/2025, 10:19
Ah je trouve La Jetée beaucoup plus immédiatement appréciable que The Stalker…
09/06/2025, 11:21
Je suis mauvais élève, je n’ai pas vu le film. Mais j’ai ouï dire que le sens de…
08/06/2025, 22:50