
Les méandres du sujet de André et les martiens deviennent progressivement tangibles à mesure que la petite heure du documentaire se déroule. Philippe Lespinasse nous embarque dans un voyage assez intime auprès d'artistes appartenant au courant de l'art brut (je ne connaissais pas, et la différence avec l'art naïf m'est encore étrangère), un terme par lequel le peintre Jean Dubuffet désigne les productions de personnes exemptes de culture artistique. L'exercice exige un minimum de pudeur et de sensibilité bien placée pour découvrir en douceur ces univers farfelus, extrêmement baroques, sans que cela ne vire au voyeurisme ou à la recherche du sensationnel. Devant sa caméra, la thématique n'a qu'à se développer délicatement, pour nous laisser contempler le spectacle de cette folie artistique et de ces saillies créatives.
André et les martiens ouvre le champ de ces mondes extraordinaires dans lesquels semblent vivre 5 individus, à la frontière de la marginalité, du handicap, et de la singularité. C'est à mes yeux un même thème voisin de celui de Le Pays du silence et de l'obscurité de Herzog, avec Fini Straubinger, une vieille dame sourde et aveugle qui a pu entendre et voir dans son enfance. Un film qui aborde notre limite de perception, notre rapport à la norme, notre carcan intellectuel et sensible. On aurait aimé en voir beaucoup plus que cette petite heure, entouré de personnes qui pensent en toute franchise et simplicité : "si Michel-Ange l'a fait, pourquoi pas moi ?". Encore que, il apparaît assez difficile de bien le cerner, André Robillard, notamment après la dernière séquence : ne serait-il pas en train de se foutre royalement de notre gueule ? Et je découvre qu’André dispose de sa propre page Wikipédia...
Il y a donc André, interné à 9 ans en 1935, fabriquant compulsivement des fusils par milliers, des fusils inoffensifs construits avec des objets très divers, regrettant que Bachar el-Assad ne les utilise pas (car ils ne font aucun mal).
Il y a Paul Amar, le grand constructeur de structures et objets en coquillages, avec des tableaux et des sculptures hors du commun, étalés entre le religieux et le grivois, qui se considère comme un bon ouvrier.
Il y a André Pailloux, un cycliste amateur avec son vélo chargé de manière très improbable mais surtout créateur de tourne-vent de toutes les couleurs, formes, et principes (et silencieux, surtout).
Il y a Richard Greaves, un architecte silencieux construisant ses cabanes poétiques au Québec selon des principes bien à lui — "les clous, ça fait mal au bois, c'est mieux la ficelle".
Et il y a Judith Scott, une jumelle trisomique abandonnée, tisseuse de cocons impressionnants, très affectueuse.
Le rapport de confiance qu'a installé le réalisateur est ténu, et même s'il est parvenu à conjuguer des dimensions sensibles et artistiques, la sensation que le documentaire aurait pu être un chef-d'œuvre est tenace. Il manque une vision, très clairement, mais aussi un minimum de technique — la qualité de l'image, de la mise en scène, du cadrage, etc. laisse vraiment à désirer. On accède ceci dit à une forme d'expression artistique totalement indépendante, évoluant presque en vase clos, sans filiation, et profondément singulière, en provenance de personnes très solitaires, évoluant dans des univers qui renversent pas mal de perspectives. Les codes esthétiques semblent abolis, l'inventivité est chaotique, des gens qui refusent la plupart du temps le qualificatif d'artiste (même si certaines de leurs œuvres se sont déjà vendues plusieurs milliers d'euros) et qui s'adonnent à une création extrêmement répétitive. Et André qui parle martien : ça n'a pas de prix.





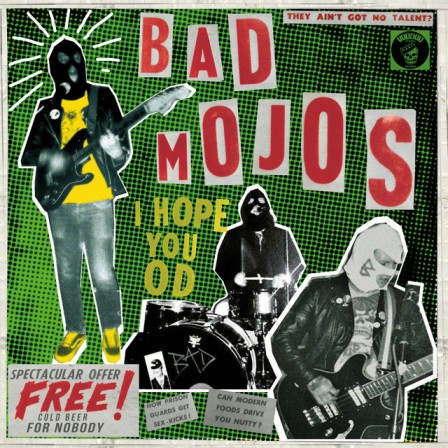






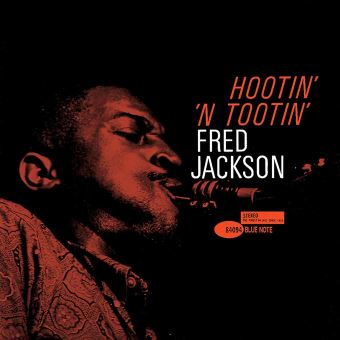













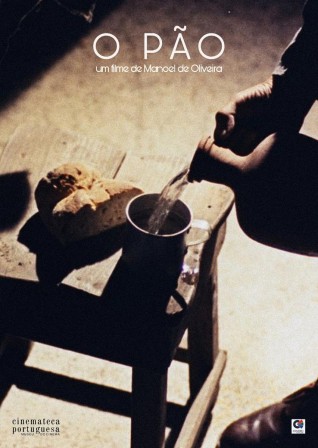






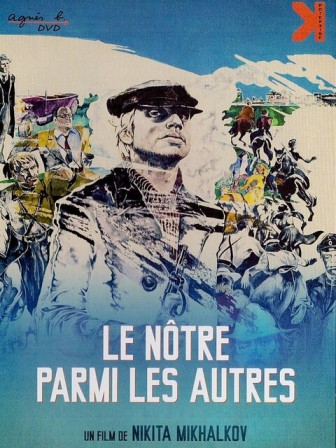

















Dernières interactions
Un sujet cousin, ce Madame Hofmann !
15/04/2024, 16:08
https://www.advitamdistribution.com...
13/04/2024, 12:45
Avec grand plaisir. :) (Cheminement intéressant !)
05/04/2024, 10:15
Salut Renaud ! Waouw tu t'es adonné à un sacré travail d'archéologie en…
05/04/2024, 09:49
Travail archéologique #2. :) (qui a l'avantage de me replonger dans certaines…
04/04/2024, 19:47
Salut Nicolas ! Waouw tu t'es adonné à un sacré travail d'archéologie en faisant…
04/04/2024, 19:40