
Lee sentiment est chez moi tenace et persistant avec Fassbinder : j'ai une sorte de revanche à prendre suite à quelques déconvenues (des films qui m'ont laissé un goût de bâclage amer, Roulette chinoise, et Le Bouc en tête) et quelques tentatives qui ont laissé l'impression d'un potentiel pas tout à fait exploité (Le Monde sur le fil et Despair dans les registres du fantastique et de la science-fiction). Tous les autres s'appellent Ali se range quant à lui dans la catégorie des faux mélodrames arborant un classicisme dévoyé comme Le Mariage de Maria Braun ou Lola, une femme allemande et m'a avant tout surpris par son côté très théorique, au sens programmatique, pour appuyer un discours reposant sur des archétypes. J'ai encore du mal à discerner ce qui est volontaire et ce qui relève de la maladresse, mais on est manifestement dans une sorte de conte qui joue avec beaucoup de clichés.
L'ambiance mélodramatique se noue autour de la rencontre de deux solitudes, et pas des moins antagoniques : une vieille dame allemande et un Marocain 20 ans plus jeune qu'elle. Dans cette relecture de Douglas Sirk, Fassbinder fait ostensiblement le portrait d'une Allemagne viciée, corrompue par un racisme acide, conduisant à la réprobation générale d'une relation jugée non-conforme. Le film est très cruel (et très machinal dans sa cruauté) pour exposer les rapports de domination et de soumission au sein des relations amoureuses, une analyse qui traverse toute son œuvre d'ailleurs il me semble : ici cela prend la forme d'une structure binaire, avec dans un premier temps un couple heureux opposé à un environnement hostile (Ali et Emmi sont victimes de la jalousie et de la médisance de tout leur entourage, en prise directe avec un racisme ordinaire) et dans un second temps un couple en crise dans un tissu local qui s'y est accommodé (le mépris fait place à une tolérance feinte et intéressée, marquée par la cupidité et l'opportunisme très commerçant de tout le monde). Le racisme est en constante mutation, et la peur dévore l’âme, comme l'indique le titre original.
Fassbinder n'y va pas de main morte pour dépeindre les contradictions de ses personnages, à l'image d'Emmi, révulsée par le racisme de ses proches mais nostalgique du nazisme au point d'aller fêter son mariage dans un restaurant fréquenté à l'époque par Hitler. Son changement de rapport avec Ali dans la seconde partie de leur relation est aussi un peu abrupt, en le transformant soudainement en un objet sexuel auprès de ses copines. En réalité le film s'apparente davantage à une sorte de conte de fées dégénéré, maniant les caricatures, avec un regard doublement pessimiste, d'un côté en dépeignant une humanité hypocrite pétrie de préjugés, et de l'autre en pointant l'impuissance du couple à surmonter l'oppression de l'entourage. Au-delà des stéréotypes omniprésents avec lesquels il faut se familiariser (et auxquels il faut adhérer), le film revêt une tonalité particulière grâce à l'interprétation de El Hedi ben Salem, amant de Fassbinder qui mourut dans une prison française à la fin des années 1970. La présence de Brigitte Mira (une habituée de Fassbinder) dans le rôle principal est aussi une source de singularité attrayante.





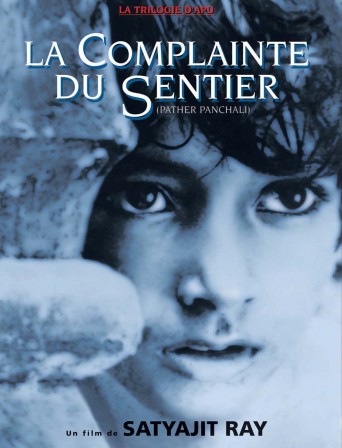









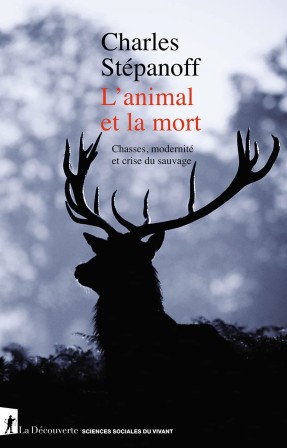
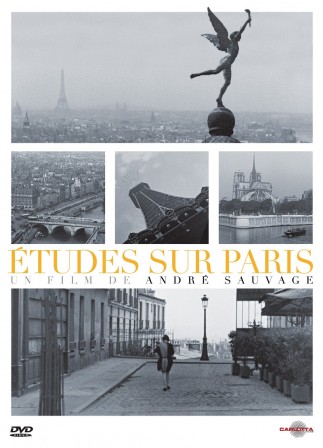







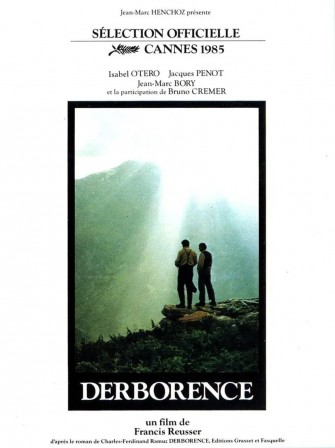




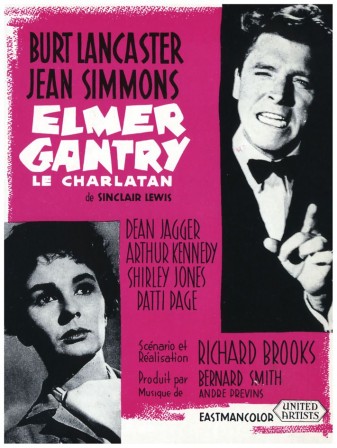







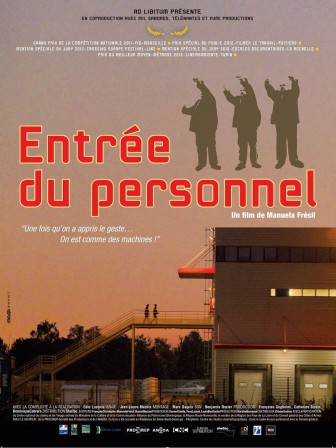

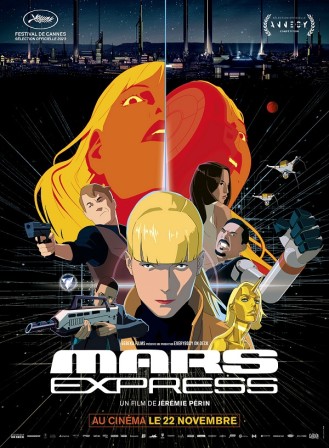





Dernières interactions
Un sujet cousin, ce Madame Hofmann !
15/04/2024, 16:08
https://www.advitamdistribution.com...
13/04/2024, 12:45
Avec grand plaisir. :) (Cheminement intéressant !)
05/04/2024, 10:15
Salut Renaud ! Waouw tu t'es adonné à un sacré travail d'archéologie en…
05/04/2024, 09:49
Travail archéologique #2. :) (qui a l'avantage de me replonger dans certaines…
04/04/2024, 19:47
Salut Nicolas ! Waouw tu t'es adonné à un sacré travail d'archéologie en faisant…
04/04/2024, 19:40