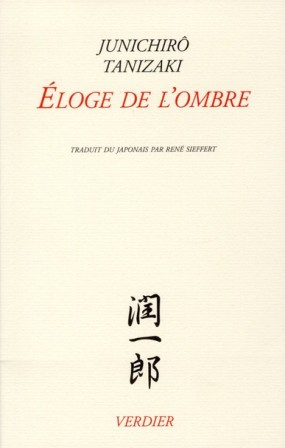
L'essai de Jun'ichirō Tanizaki sur l'esthétique japonaise est à la fois court, dense, et déconcertant. Il faut dire que pour aborder la question du beau, et avant de développer sa pensée sur l'opposition entre l'esthétique asiatique basée sur l'ombre et l'esthétique occidentale basée sur le visible, il nous embarque directement... dans ses toilettes. Point de départ assez déroutant pour une réflexion qui ne se révèlera que très progressivement, en prenant le lecteur (occidental mécréant, du moins) à rebours, et qui laissera beaucoup de zones d'ombre — c'est sans doute une sensation très à propos, au regard de la thématique.
Chose amusante et intéressante, il est difficile de caractériser la position de Tanizaki, réactionnaire sous certains aspects, mais doué d'autodérision sous d'autres : il se moquera de lui-même à de nombreuses reprises, qualifiant ses paroles de divagations de vieillard (il n'a que 47 ans). Parfois, il se fait extrêmement véhément et peu nuancé pour critiquer la définition du beau en Occident ou pour glorifier la culture nationale patriotique, et parfois il avance ses pensées sous l'angle de l'incompréhension sincère et posée, en avouant le caractère relatif de ses jugements. S'il finit par explorer des thèmes artistiques plus conventionnels, comme le théâtre (en opposant Kabuki et Nô) ou des architectures spectaculaires, il s'attarde très longuement sur les éléments du quotidien en s'intéressant aux intérieurs d'une maison. Et de pester sur l'électricité (qu'il installera dans sa maison malgré tout), sur ces lumières trop fortes et trop chaudes qui dénature le cœur même de la maison japonaise en éliminant, entre autres, la pénombre des alcôves.
On en vient souvent à se demander ce que Tanizaki pensera de l'occidentalisation de la société japonaise au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, lui qui souffre déjà énormément de l'évolution culturelle à marche forcée au tout début des années 1930. L'écrivain donne l'impression d'être un apôtre de l'ombre comme un parent éloigné de Soulages, insistant sur le fait que la clarté à quelque chose d'aveuglant, et que la où les occidentaux s'échinent à astiquer leurs objets d'art, les asiatiques trouvent une finalité toute particulière dans la patine de la crasse. Un attrait pour la souillure, vecteur du temps qui passe, qui rend plus attrayant le jade terne plutôt que le diamant étincelant.
Un essai difficile à appréhender, derrière sa fausse désinvolture il est très stimulant dans son ébauche de théorisation sur l'esthétique, mais il multiplie en outre les dissonances, d'un côté capable de commentaire bassement raciste à l'encontre d'Einstein en visite au Japon s'étonnant d'un éclairage public fonctionnant en plein jour ("c’était un Juif, après tout"), et quelques pages plus loin se moque de lui-même de peur de devenir, voire d'être devenu, un vieux réac grabataire. La dernière partie de cet Éloge de l'ombre est plus confuse, moins précise, on aborde la soupe miso dans un bol sombre et les sushis enveloppés dans des feuilles de kaki, disons que ces divagations sont moins intéressantes que celles sur la blancheur de la porcelaine, l'intérieur et les toits des temples ou encore les contrastes colorimétriques de la peau (avec option "noircissement des dents" pour les femmes). Une chose est sûre, on referme le livre en observant son environnement différemment, en traquant toutes les zones d'ombre avec l'envie, comme Tanizaki dans sa conclusion presque potache, d'aller "éteindre [sa] lampe électrique".


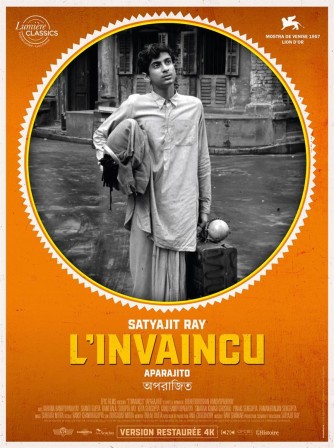















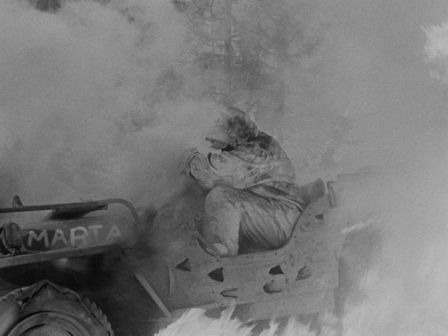



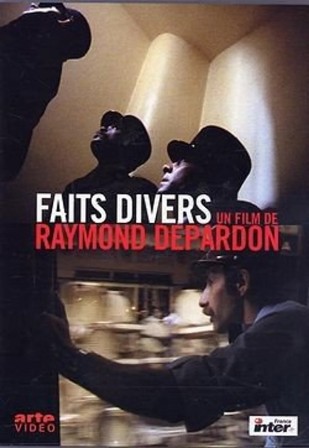






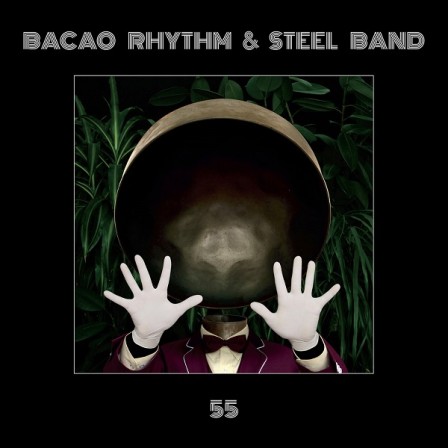

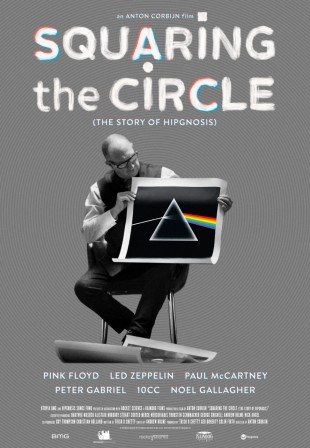






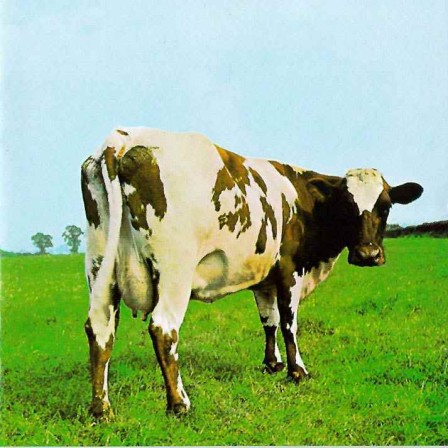

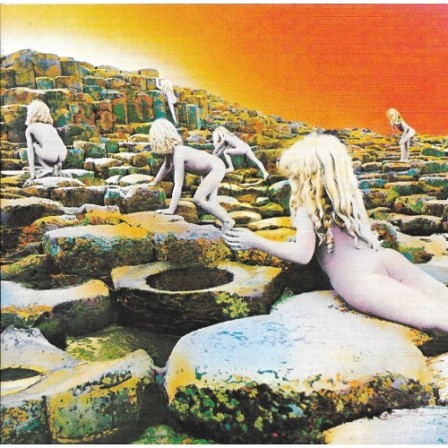

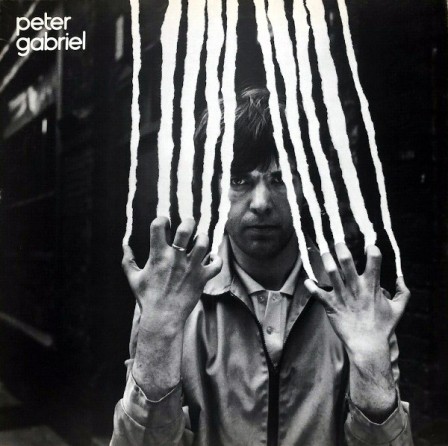


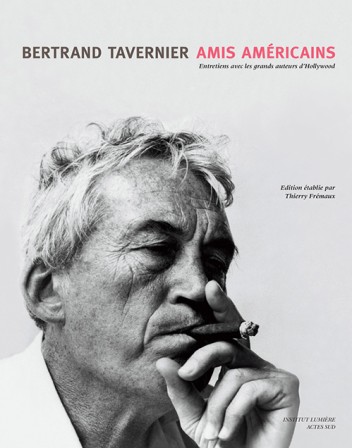






Dernières interactions
Un sujet cousin, ce Madame Hofmann !
15/04/2024, 16:08
https://www.advitamdistribution.com...
13/04/2024, 12:45
Avec grand plaisir. :) (Cheminement intéressant !)
05/04/2024, 10:15
Salut Renaud ! Waouw tu t'es adonné à un sacré travail d'archéologie en…
05/04/2024, 09:49
Travail archéologique #2. :) (qui a l'avantage de me replonger dans certaines…
04/04/2024, 19:47
Salut Nicolas ! Waouw tu t'es adonné à un sacré travail d'archéologie en faisant…
04/04/2024, 19:40