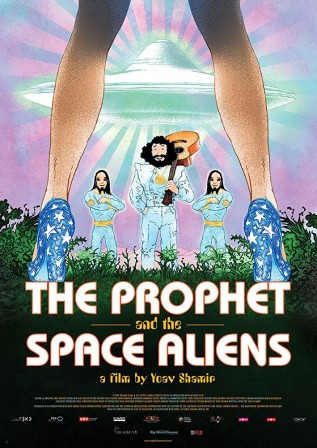
Tout le monde a déjà entendu parler de Raël et de sa secte, mais rarement peut-on voir le fonctionnement du mouvement et l'organisation de sa pensée autant que de sa hiérarchie à travers le monde de manière aussi claire et apaisée que dans The Prophet and the Space Aliens, un documentaire extrêmement respectueux, drôle et bien construit réalisé par Yoav Shamir. Ce qui fait toute la qualité d'un tel film peut se résumer à une disposition assez simple : on peut être sûr qu'un raélien (voire Raël lui-même) approuvera tout ce qui est dit et montré ici, à une ou deux exceptions près, et dans le même temps, vu de l'extérieur, il permet très clairement de voir tout ce qui cloche, de manière évidente.
Le réalisateur, qui a approché le mouvement de manière naïve et désintéressée dans un premier temps (il fut invité pour y recevoir un prix inventé par Raël sans être au courant), construit son docu de manière très élégante, en alternant les moments très "documentant" et les moments comiques — d'un humour sincère et jamais méprisant, laissant à chacun le soin de se construire son avis. Même lorsqu'il s'entretient avec d'anciennes connaissances de Claude Vorilhon (son vrai nom) dans les années 70, avant tout le délire lié aux extra-terrestres et au clonage, il laisse la place aux détracteurs de ne pas se sentir acculés. Mais tout de même : l'idée que Raël, selon d'anciens potes à lui, du temps où il œuvrait comme chanteur imitant Brel ou comme directeur de publication d'un magazine de sports automobiles "Autopop", se serait inspiré de Fluide Glacial pour certaines de ses "expériences" (typiquement sa présence lors d'un banquet réunissant les chefs de diverses religions) est tout simplement géniale. Gotlib, le vrai mentor de Raël, ça a quand même de la gueule.
Raël vit vraisemblablement au Japon, dans une immense maison gracieusement offerte par un de ses fidèles (le docu ne s'attarde pas sur les opérations financières du groupe en Suisse et au Liechtenstein), où il peut tranquillement observer le soleil du lever au coucher, dans son éternel accoutrement d'un blanc immaculé, entouré par ses plus proches fidèles (retenues pour leur beauté intérieure et extérieure, ça tombe bien), distinguées par des plumes de couleurs différentes, en attendant l'arrivée des Elohim, les fameux extra-terrestres. On voit Raël le sportif qui joue à la pétanque, Raël le rhétoricien qui tient tête à des Mormons en leur refilant un de ses propres livrets ("they were not lucky today" dira-t-il juste après, avec un sourire espiègle), Raël la superstar hippie qui interprète quelques-uns de ses morceaux ("we are one with eternity, we are one with infinity", etc.), Raël l'orateur international qui tient une visioconférence au Burkina Faso.
Pour chaque côté moralement détestable (comme par exemple le prosélytisme évident et l'exploitation de la faiblesse de certaines personnes, notamment en Afrique avec la lutte contre l'excision), il y a toujours un autre côté plutôt drôle (le coup de la clitbox, un projet visant à financer la chirurgie réparatrice en invitant à cotiser à chaque orgasme). Yoav Shamir a eu en outre la bonne idée (pas tout à fait exploitée) de questionner un professeur des religions de Berkeley pour savoir quelle attitude adopter et quelles bonnes questions poser, ainsi que de creuser la piste de ce qui resterait de cette croyance après la découverte hypothétique d'un mensonge. L'épisode de l'annonce (évidemment jamais prouvée) du tout premier clonage humain en 2002, à travers Brigitte Boisselier, présidente de la société fantôme Clonaid, et tout l'écho que cet événement a engendré par la suite, en donne une très bonne idée.



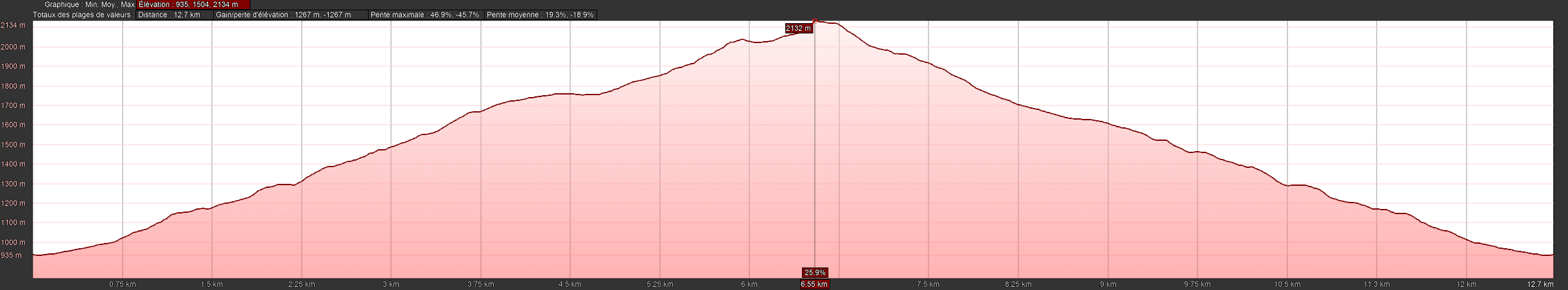

















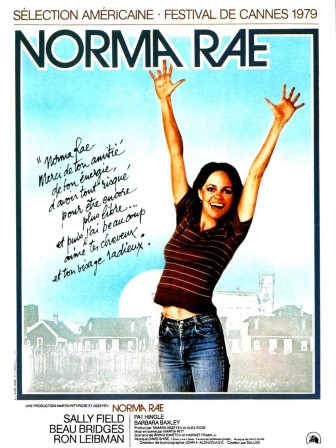











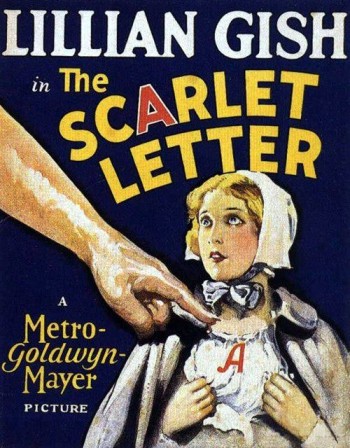












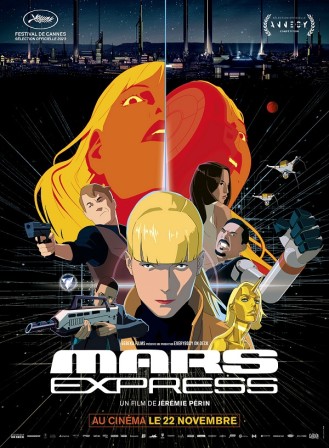





Dernières interactions
Bonjour Michel, Merci pour ce retour ! C'est vrai que les noms des (très…
16/05/2024, 17:15
Bonjour, Bel article pour un film que j'ai adoré. Un vrai bon film avec un…
16/05/2024, 17:10
Ah, étonnant ! Je parlais de SF au sens général, indépendamment du support, mais…
14/05/2024, 10:47
Pareil que Nicolas. Je n’en ai pas vu beaucoup mais celui-ci me tente. Je n’ai…
13/05/2024, 10:58
Merci pour le passage et merci pour la découverte de cette auteure, j’y…
13/05/2024, 10:28
Bonjour Simon, Je serais curieux de savoir comment tu as su que j'avais vu ce…
12/05/2024, 16:01