
Plans fixes, photographie léchée, dialogues marginalisés, thématique pertinente : aucun doute, on est bien chez Nikolaus Geyrhalter. L'agro-industrie dans Notre pain quotidien, l'humanité la nuit dans Abendland, les vestiges d'architectures passées dans Homo sapiens, la transformation et l'exploitation des paysages dans Earth, et désormais la gestion des déchets à l'occasion de Exogène qui ne dépareille pas le moins du monde avec le reste de sa brillante filmographie documentaire.
Geyrhalter est allé chercher des détritus à plusieurs endroits de la Terre (Albanie / Autriche / États-Unis / Grèce / Maldives / Népal / Suisse) et il n'y a pas l'ombre d'un doute quant à l'intérêt de son bilan carbone. Le documentaire est hypnotisant, comme à son habitude au demeurant, mais ici avec un supplément de fascination assez particulier étant donné que l'objet du regard porte sur de la saleté sous toutes ses formes. Du plastique partout, évidemment (et on sait bien qu'une partie finira chez les déshérités exploités à l'autre bout du globe, de Plastic China à Welcome to Sodom), en montagne, sous l'eau, sur les rivages, enfoui sous terre, mais aussi le tout-venant, qu'il soit collecté à vélo dans les rues d'un petit village népalais avant d'être entreposé dans une décharge à ciel ouvert, en camion suspendu sous un téléphérique suisse ou en bateau au large des côtes maldiviennes. Le réalisateur autrichien parvient à unifier en quelque sorte les détritus déversés aux quatre coins de la planète pour former une même masse polluante qui prolifère et qui s'infiltre par toutes les strates jusqu'à se répandre jusque dans les territoires les plus reculés.
Et il en faut, de l'énergie pour traiter ces déchets. Des bénévoles qui collectent ce que les flots ont ramené sur des plages albanaises, des plongeurs grecs qui vont récurer les fonds marins particulièrement garnis en saloperies incrustés dans les coraux, et des machines à n'en plus finir pour les déplacer, les compacter, les trier, les recycler, ou les réduire en miette ou en pâte. Des machines de toutes les tailles, que l'on a tout le loisir d'observer dans leurs fonctionnements variés, du bulldozer servant à donner un semblant d'ordre dans les décharges à perte de vue jusqu'aux broyeuses qui fragmentent n'importe quelle matière, en passant par les différents souffleurs et aimants géants pour séparer les objets légers et les métaux du reste. On regarde toutes cette mécanique fonctionner avec autant de passion que de dégoût, un tour de force récurrent chez Geyrhalter. On est à deux doigts de l'autonomie au sein d'un système fermé, avec des déchets qui produisent des déchets, qui produisent des déchets, etc. La nausée et l'asphyxie guettent à plus d'une reprise.
Geyrhalter travaille beaucoup ses transitions. On passe d'une mer prise entre des montagnes glacées magnifiques tant que l'on ne regarde pas en détail les ilots de plastique qui la composent, au bordel monstrueux dans une décharge au Népal, avec des déchets qui s'accumulent en montagnes traitées par une armée de petites mains au milieu du ballet de camions, pour ensuite sauter tout aussi brusquement vers une station de ski en Suisse avec des camions qui n'arrêtent par leurs descentes et leurs montées fixés en-dessous des cages d'acier transportant les hommes — un procédé qui apparaît naturellement comme un luxe. Le final observant la clôture du Burning Man dans le Nevada est un moment hautement photogénique (autant que les plages de sable blanc aux Maldives), le désert balayé par la poussière et par le vent, avec des dizaines de personnes cherchant quelques pauvres petits bouts d'ordures, contraste saisissant avec les tonnes et les tonnes de déchets qui ont défilé devant nos yeux avant ça — le propos n'étant pas tout à fait clair à cet endroit. Une chose est sûre, il y a quelque chose de l'ordre du travail de Sisyphe dans cette dispersion planétaire des ordures que l'humain cherche à dompter, à brûler et à enfouir, quête éternelle au bord de l'impuissance.






















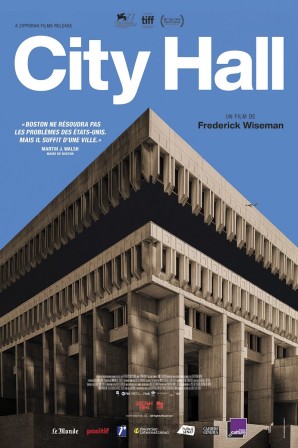






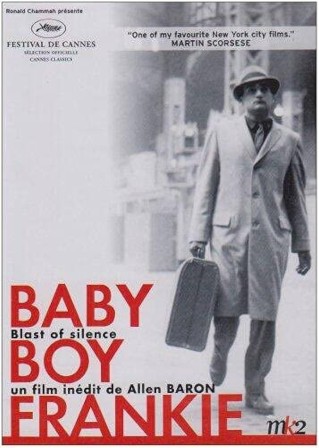



















































Dernières interactions
Un sujet cousin, ce Madame Hofmann !
15/04/2024, 16:08
https://www.advitamdistribution.com...
13/04/2024, 12:45
Avec grand plaisir. :) (Cheminement intéressant !)
05/04/2024, 10:15
Salut Renaud ! Waouw tu t'es adonné à un sacré travail d'archéologie en…
05/04/2024, 09:49
Travail archéologique #2. :) (qui a l'avantage de me replonger dans certaines…
04/04/2024, 19:47
Salut Nicolas ! Waouw tu t'es adonné à un sacré travail d'archéologie en faisant…
04/04/2024, 19:40