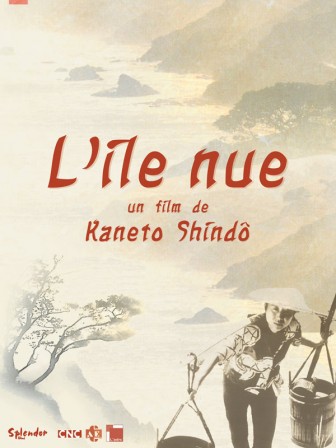
Le dur labeur d'un Sisyphe insulaire
On pourrait croire qu’avec de tels partis pris esthétiques et narratifs, aussi puissants que radicaux, L’Île nue constituerait l’essence même de l’œuvre profondément clivante. En choisissant comme cadre un îlot au sud du Japon, isolé au sein d’une mer intérieure, Kaneto Shindō aurait pu se contenter d’un récit à la structure simple et laisser parler ces images fabuleuses. Mais ce n'est pas le cas, ce serait mal le connaître. Pour témoigner sur un ton quasi-documentaire de la dureté de la vie et du labeur paysans sous de telles latitudes, il adopte une perspective proche du cinéma muet, sans aucun dialogue, mais avec un environnement sonore foisonnant. Et le résultat est saisissant : la poésie déjà présente naturellement au creux de ces paysages et de ce rythme de vie séculaire semble portée à son paroxysme.
On retrouve Nobuko Otowa (actrice proche de Shindō que l’on peut admirer dans les très bons Onibaba ou The Black Cat) dans le rôle d’une agricultrice, habitante de l’îlot perdu avec son mari et ses deux enfants. L’essentiel des journées de la famille est rythmé par l’inexorable tâche liée à l’eau douce : au dur labeur d’agriculteur se joint celui non moins dur de porteur d’eau, qu’il faut aller chercher sur l’île principale. C’est un véritable rituel, incroyablement répétitif et à ce titre éprouvant, matérialisé par deux sceaux portés sur les épaules et transportés en barque d’une rive à l’autre. La préciosité infinie de l’eau devient ainsi palpable, et presque paradoxale étant donnée l’omniprésence de l’eau (salée) avoisinante. L’insistance et la minutie avec lesquelles est filmée l’arrosage des rangées de plants à flanc de colline, par tout petits sceaux cette fois-ci, ainsi que les bruitages qui accompagnent cette cérémonie, confèrent à l’eau douce et au travail de la terre une valeur inestimable.
Mais pour pleinement apprécier L’Île nue, il faut réussir à franchir une première étape, celle que nous impose Shindō lors de la première demi-heure sous la forme d’un ballet incessant, extrêmement répétitif d'un point de vue narratif, visuel et sonore, à la chorégraphie parfaitement orchestrée. À la simplicité des tâches prises de manière individuelle (remplir des sceaux, conduire une barque, arroser, etc.) se substitue une forme de difficulté insurmontable. Un travail herculéen qui revisite le mythe de Sisyphe (arroser, sans cesse, en transportant de lourds sceaux d’eau douce) de la même manière que le revisitait La Femme des sables avec du sable. C’est une entrée en matière qui peut être très rebutante, mais pour peu qu’on y soit sensible, elle finit par libérer une puissance poétique étonnante et détonante, axée sur la pénibilité d'une tâche nécessaire, un peu comme la sève que parvenaient à extraire Jean Epstein ou Robert Flaherty des plus durs travaux dans Finis terrae, Nanouk l’esquimau et L'Homme d'Aran. C'est la quintessence pour nous d'un quotidien banal pour eux, capté dans un élan lyrique relativement austère.
C'est seulement une fois ce cap de la répétition passé et ce cycle de l'eau appréhendé que l'ambiance visuelle et l'environnement sonore peuvent pleinement produire leur effet.

Visuellement, c'est Mikhaïl Kalatozov (ou plutôt Sergueï Ouroussevski, son chef opérateur) qui est convoqué dès la séquence d'introduction : ces plans tournés à bord d'un hélicoptère dévoilant le caractère majestueux de l'île en travelling avant au début puis en travelling arrière à la fin font irrémédiablement et anachroniquement penser à deux de ses œuvres : l'introduction de Soy Cuba (1964) et la conclusion de La Lettre inachevée (1960). En dressant le portrait d'un mode de vie ancestral, presque entièrement dédié à l'île et à son microcosme, sans repère visuel notable, on finit par oublier quelque repère temporel que ce soit et on accepte ce récit comme un conte hors du temps. Il faudra attendre un court épisode en ville, séjour effectué par pure nécessité, pour réaliser que les années 60 ont bien atteint le Japon : les images de danseuses pop à la télévision renvoient celles de la famille insulaire et paysanne à un imaginaire presque médiéval.
Du point de vue sonore, on reste dans l'expérimentation et dans une approche relativement contre-intuitive. L'utilisation du (quasi-)muet ne se fait pas ou très peu selon les codes et les formes d'expression classiques du cinéma muet, à base d'exagérations propres au burlesque ou au mélodrame par exemple. Non, l'approche est encore une fois proche du documentaire : les arrangements musicaux sont relativement discrets et accompagnent l'action sans la souligner de manière exagérée. La culture de cette terre ingrate produit une constellation bigarrée de sons en tous genres, comme le bruit de l'eau versée sur la terre, des sceaux en bambou qui s'entrechoquent, du vent qui souffle dans les branches. Le paysage sonore parachève cette idée de poème cinématographique mettant en scène des êtres humains luttant noblement mais inexorablement contre les forces de la nature, comme un instantané de l'équilibre parfait entre la beauté du cadre et l'âpreté de son contenu.












Dernières interactions
Ah je serais très heureux d'avoir ton avis là-dessus ! C'est mon gros coup de…
24/06/2025, 11:54
Merci pour cette chronique sensiblement enthousiaste. Il est fort parfois le…
24/06/2025, 10:49
Ouch ou encore Civil war d’Alex Garland (2024)
12/06/2025, 16:03
Décidément, on se rapproche de l'introduction d'un prochain volet d'American…
12/06/2025, 10:19
Ah je trouve La Jetée beaucoup plus immédiatement appréciable que The Stalker…
09/06/2025, 11:21
Je suis mauvais élève, je n’ai pas vu le film. Mais j’ai ouï dire que le sens de…
08/06/2025, 22:50