
Elles sont rares les fictions du XXIe siècle à se faire aussi ambitieuses, originales, mystérieuses, et insaisissables sans pour autant être inregardables ou désagréables. À réussir à compenser leurs inévitables maladresses par autre chose. La réussite d'un tel film est à mes yeux multiple : d'abord, Cate Blanchett, évidemment, elle crève l'écran et le monopolise pendant près de trois heures, et il faut dire qu'elle gère extrêmement bien ce rôle de cheffe d'orchestre allemande. Le portrait qu'elle dessine est délicieux, riche, plein de zones d'ombre, morcelé en part explicites et inconscientes, difficile à cerner dans ses évolutions saccadées. Il y aussi la description d'une personne hautement singulière, une artiste au sommet de sa carrière et de son art, disposant de latitudes extrêmement larges qui lui sont concédées précisément parce qu'elle est un peu une étoile céleste. Et c'est un point fort du film de Todd Field, comment dans une longue première partie on ne peut que constater ce sentiment de domination à tous les niveaux, décomplexé, lié à une supériorité intellectuelle écrasante et très consciente. Tant que tous les engrenages sont bien huilés, tant que l'entourage cautionne bon nombre de manifestations d'impertinence arrogante et blessante, on tolère pas mal d'écarts, de conduites autoritaires, d'abus de pouvoir. Mais cela ne dure qu'un temps.
Le film adopte la dynamique du rise and fall un peu classique, mais il n'empêche, la trajectoire de Lydia Tár est aussi captivante qu'étincelante. J'ai beaucoup aimé la toile de fond de l'artiste dans son univers, dans un microcosme très stimulant, privilégié, préoccupée par son prochain livre et sa symphonie de Mahler en préparation avec sa flopée de musiciens qu'elle gère de manière autocratique (elle dira bien "ce n'est pas une démocratie"). Tár est excellent quand il fait émerger des sentiments contradictoires au moment où la carrière de la cheffe d'orchestre commence à se désagréger, faisant peu à peu amplifier la nausée de ses comportements déplacés. On passe du rire magnanime à la gêne confuse. La pression qu'elle exerce sur son entourage, autant que sa domination intellectuelle (et son name dropping, aussi, par moments) comme arme de pouvoir, prendront une toute autre couleur une fois passée de l'autre côté de la reconnaissance.
Quelques passages ratés, forcément, à l'image de l'irruption de Lydia en plein concert pour illustrer à gros traits sa rage contre un chef d'orchestre concurrent.
C'est bien sûr un film un peu élitiste, qui ne ménage pas son côté intellectuel, sans doute prétentieux sous certains aspects, et donc hermétique — il faut réussir à passer la première heure, grossièrement. Mais c'est aussi un film qui aborde une grande quantité de thèmes que je trouve passionnants, les dérives du pouvoir, l'absolutisme du génie, la confrontation entre les mondes (ancien et moderne, classe favorisée et classe moyenne), l'angoisse de la vieillesse et la misère sentimentale qui peut advenir, les étincelles provoquées par la rencontre entre le savoir ancien, massif, intimidant, et l'immédiateté des réseaux sociaux joints aux préoccupations sociales urgentes, ou encore la place délicate de l'art comme culte de la performance dans un système égalitaire. Le film arbore en plus de cela des aspects comiques (parfois tragiques, comme l'échange hilarant entre Blanchett et ses voisins de palier qui trouvent qu'elle fait du bruit et que cela nuit aux visites alors qu'elle pensait qu'ils voulaient la congratuler comme elle en a trop l'habitude) et d'autres très oniriques ou étranges (cauchemars, présence répétée de la femme rousse, final dans un pays asiatique) qui en font une curiosité très recommandable. Un film insaisissable, rempli de recoins à explorer.









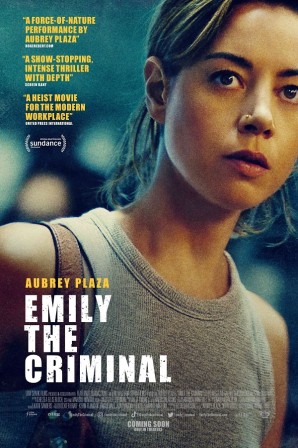










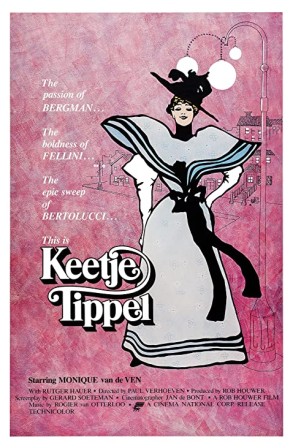






























Dernières interactions
Un sujet cousin, ce Madame Hofmann !
15/04/2024, 16:08
https://www.advitamdistribution.com...
13/04/2024, 12:45
Avec grand plaisir. :) (Cheminement intéressant !)
05/04/2024, 10:15
Salut Renaud ! Waouw tu t'es adonné à un sacré travail d'archéologie en…
05/04/2024, 09:49
Travail archéologique #2. :) (qui a l'avantage de me replonger dans certaines…
04/04/2024, 19:47
Salut Nicolas ! Waouw tu t'es adonné à un sacré travail d'archéologie en faisant…
04/04/2024, 19:40