
Cette nouvelle adaptation de À l'Ouest, rien de nouveau (90 ans après celle de Lewis Milestone) est une réponse cinglante et fort à propos au regard qu'avait porté Sam Mendes sur la Première Guerre mondiale à travers son 1917 il y a trois ans, tout en plans-séquences hors sol et en propreté déplacée. La version de Edward Berger est loin d'être irréprochable mais elle est d'une efficacité et d'une pertinence toutes autres à mes yeux, tout en explorant une piste graphique d'ampleur similaire.
Esthétiquement, on peut déjà dire que le budget (merci Netflix je suppose) permet de mettre en scène de très nombreuses séquences avec puissance, que ce soit via certains plans-séquences marquants (l'introduction par exemple, même si le schéma commence presque à devenir un cliché) ou dans l'instauration d'un climat glacé apocalyptique (très beaux éclairages opposant le froid bleuté de la neige et les sources lumineuses rougeoyantes). Les classiques sont là, neige, boue, sang, mais tout est exécuté avec précision.
Ce point de vue, allemand, est quand même infiniment plus intéressant que ce que Mendes a pu proposer il me semble. Un film sur une défaite sera en un sens toujours plus beau que celui sur une victoire, et ici la bataille est double : en cette fin de guerre, les combats font rage dans le nord-est de la France tandis que les généraux négocient l'armistice. Le film n'est pas du tout exempt de clichés, de raccourcis, de passages trop appuyés : notamment j'ai été assez déçu par les trois derniers quarts d'heure, vraiment de trop dans le registre du surplus d'horreur. Il y avait quand même de la marge pour éviter le happy end, pas la peine de sombrer dans un tel cocktail de boucherie et de stupidité guerrière pour terminer la grande parabole qui avait commencé avec l'euphorie des jeunes troupes en introduction (un peu minée par l'épisode de l'étiquette). Deux fautes de goût notables : la répétition de la séquence chez les fermiers, qui tourne mal, et la concomitance armistice / mort d'un personnage. Pas trop emballé non plus par le contraste poussif entre l'horreur viscérale des tranchées et le calme propre de l'intérieur des salons des généraux : c'est vraiment superflu, au cinéma, quoique bien relié à une vérité historique. Même constat au sujet de l'opposition Foch / Erzberger.
Cela étant dit, il y a quelque chose de fascinant dans la beauté de la mise en scène sans cesse corrélée avec l'ampleur de la boucherie, avec de très nombreux gros plans sur des horreurs sanglantes — peut-être un peu trop de plans fixes insistant sur certains cadavres, mais c'est selon les goûts. La peur qui gonfle dans les rangs allemands est rendue avec beaucoup d'intensité, et je pense qu'on se rappellera pendant longtemps de l'arrivée des chars français sur le champ de bataille, ainsi que des lance-flammes et les avions. Glaçant. Au même titre que toutes les scènes de bataille ceci dit, très bien mises en scène. J'ai en outre étonnamment apprécié l'utilisation très anachronique de la musique, qu'on croirait parfois sortie des mains de Hans Zimmer pour un film de science-fiction : très surprenant.



















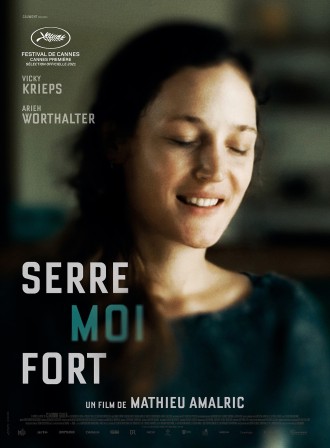




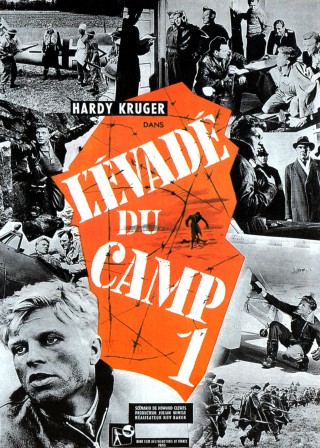






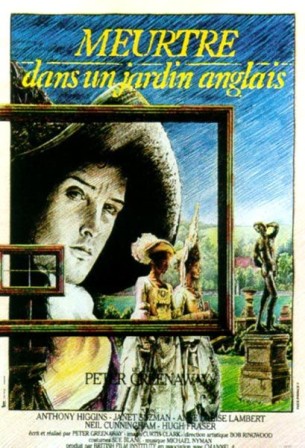













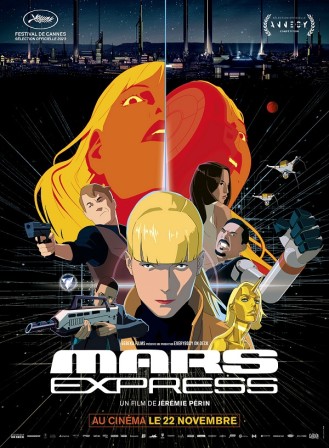





Dernières interactions
Un sujet cousin, ce Madame Hofmann !
15/04/2024, 16:08
https://www.advitamdistribution.com...
13/04/2024, 12:45
Avec grand plaisir. :) (Cheminement intéressant !)
05/04/2024, 10:15
Salut Renaud ! Waouw tu t'es adonné à un sacré travail d'archéologie en…
05/04/2024, 09:49
Travail archéologique #2. :) (qui a l'avantage de me replonger dans certaines…
04/04/2024, 19:47
Salut Nicolas ! Waouw tu t'es adonné à un sacré travail d'archéologie en faisant…
04/04/2024, 19:40