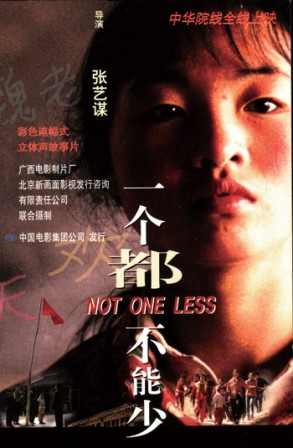
L'intention première d'un film comme Pas un de moins, qui appartient à la période sobre de Zhang Yimou (c'est-à-dire sorti avant les années 2000), est de raconter la vie dans un petit village chinois isolé, Shuiquan, situé dans la province Hebei. L'histoire est celle de Wei Minzhi, 13 ans, chargée de remplacer un professeur d'école primaire devant s'absenter pour un mois : on comprend qu'elle est choisie à défaut d'avoir trouvé quelqu'un de plus âgé et parce qu'elle est sans doute la plus compétente pour encadrer cette classe d'enfants qui n'ont que quelques années de moins qu'elle. Les conditions sont drastiques si ce n'est spartiates, le sol est en terre battue, l'unique salle de l'école jouxte la petite pièce servant de bureau et de chambre à Minzhi ainsi qu'à quelques élèves, et on en est même à rationner les craies comme une matière rare. Il y avait 40 élèves il y a quelque temps, et il n'y en a plus que 28 : la mission confiée à la toute jeune institutrice, c'est de maintenir cet effectif durant son remplacement.
Toute la beauté d'un tel film tient non pas, à mes yeux, aux grandes lignes directrices qui structurent la narration (opposition entre ville et campagne, recherche d'un enfant parti de l'école à cause de l'extrême pauvreté de sa famille) mais bien davantage au fait que la majorité des acteurs sont non-professionnels, et bien dirigés dans des rôles qui sont les leurs dans la réalité. Il s'en dégage une sincérité très émouvante, quand les conditions sont réunies, qui plus est dans une configuration aussi modeste et bien réelle. Il y a bien ce petit côté feel-good movie, avec un grand message d'espoir et des cartons finaux probablement imposés par la censure, mais disons que le charme de la jeune prof MingZhi et de l'enfant des rues Zhang Huike compensent cela plus que correctement.
C'est donc en dépit des messages gouvernementaux et d'une fin digne d'un happy end hollywoodien que Zhang Yimou parvient à décrire d'une part le quotidien d'un village rural très pauvre et d'autre part la confrontation de cet univers avec la jungle urbaine, lorsque Mingzhi doit partir chercher Huike dans l'immensité de la ville. L'écart est immense, comme si un siècle séparait les deux environnements, et on ressent l'influence de cinéastes comme Abbas Kiarostami à de multiples niveaux : le regard sur l'enfance, le style poético-documentaire pour capter la ruralité, et cette frontière brouillée entre réalité et fiction.





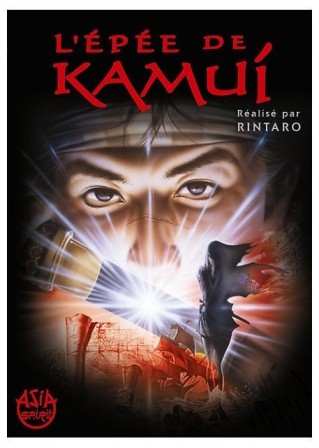




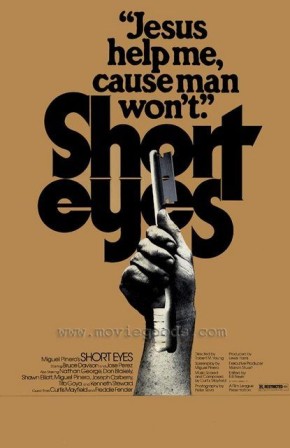









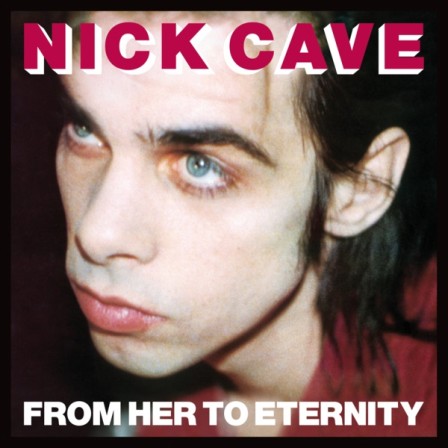






























Dernières interactions
Un sujet cousin, ce Madame Hofmann !
15/04/2024, 16:08
https://www.advitamdistribution.com...
13/04/2024, 12:45
Avec grand plaisir. :) (Cheminement intéressant !)
05/04/2024, 10:15
Salut Renaud ! Waouw tu t'es adonné à un sacré travail d'archéologie en…
05/04/2024, 09:49
Travail archéologique #2. :) (qui a l'avantage de me replonger dans certaines…
04/04/2024, 19:47
Salut Nicolas ! Waouw tu t'es adonné à un sacré travail d'archéologie en faisant…
04/04/2024, 19:40