
Mon plus grand regret concernant Le Retour des hirondelles porte sur la surcouche explicative et sur-explicite qui enveloppe tout le reste, au risque de laisser un arrière-goût amer là où l'histoire de ce mariage arrangé entre deux êtres rejetés par leurs familles qui trouveront un épanouissement en milieu rural avait de beaux et sérieux arguments ne nécessitant pas un tel niveau d'insistance. Le film, long et lent, a très souvent recours à des scènes très insistantes au sujet des différentes contraintes qui pèsent sur le couple ainsi qu'à des symboles très appuyés qui ne lui font pas vraiment honneur. C'est d'autant plus dommage que Li Ruijun parvient à capter, apparemment sans trop forcer, la beauté de ces régions rurales du nord de la Chine.
L'image (graphique) de l'épi de blé qui se sèche, l'image (symbolique) du paysan méprisé seul à même de donner son sang à un citadin beaucoup mieux loti que lui... Des dispositifs de mise en scène de cet acabit, le film en est rempli, et le visionnage se révèle malheureusement moins fluide, naturel et agréable à cause de ces sursauts.
Il y a quelque chose de très simple dans la dynamique du rapport amoureux entre les deux protagonistes, tout d'abord sujets à une timidité évidente, en lien avec la méthode artificielle qui les a réunis, cédant peu à peu la place à une certaine affection — bon on est tout de même en milieu paysan donc le film insiste sur le côté un peu bourrin à ce niveau-là avec un peu trop d'emphase, mais qu'importe. La beauté du film tient également à la subsistance de leur amour, au travers de nombreuses marques d'affection (notamment au travers du rite des grains de blé appliqués sur la peau), tandis que le monde agricole environnant se désagrège — ici aussi la source de nombreuses facilités scénaristiques, sans doute en prise avec une réalité avérée, mais pas tellement fonctionnelles du point de vue cinématographique.
Le film a d'ailleurs subi la censure en Chine, puisqu'il a été retiré des circuits de diffusion fin 2022 : le message de la destruction de la ruralité, de l'exode urbain forcé, sur fond de corruption à peine voilée, est éminemment politique. La copie que j'ai pu voir est d'ailleurs sans doute entachée de censure, la dernière scène avec Ma ayant été amputée et une phrase de dialogue (alors que les personnages présents ne dialoguent pas, très étrange ou plus précisément très mal fait) ayant été rajoutée lors de la destruction finale de leur maison.
Restera malgré tout ce rythme très contemplatif, au fil des saisons extrêmement photogéniques, pour décrire ce microcosme éloigné de la toxicité de la ville et de ses compromissions. Bien sûr, ils refusent les appartements sans âme dans lesquels on les invite fortement à déménager, pour y préférer la maison en terre cuite qu'ils se sont construite. C'est dans et autour de ce lieu chaleureux que la solidarité entre les deux parias est née, en parallèle du cycle des cultures, malgré les nombreuses formes d'exploitation, en résistance à la désagrégation des communautés paysannes.






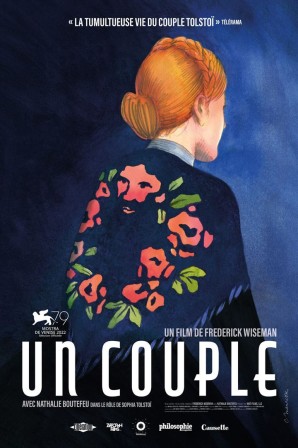







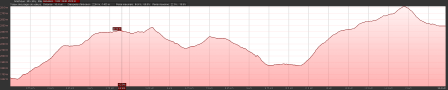
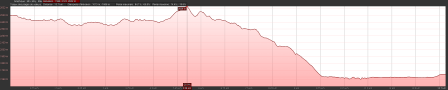























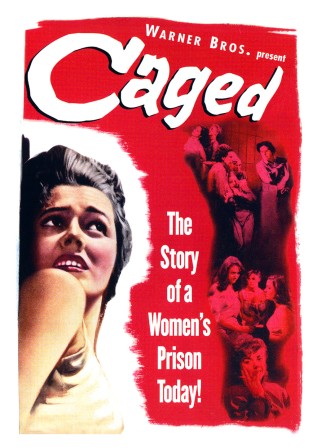












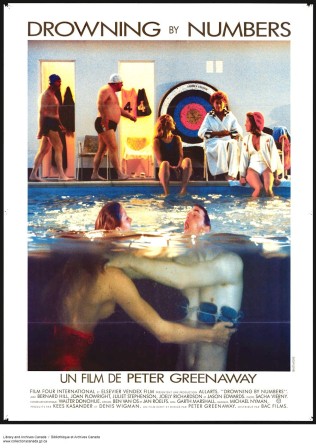





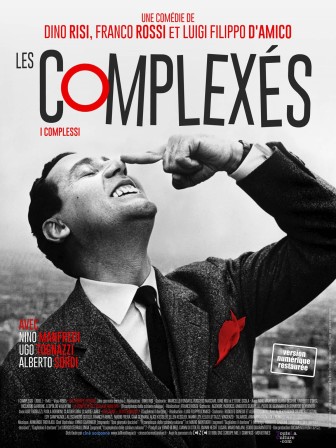



















Dernières interactions
Un sujet cousin, ce Madame Hofmann !
15/04/2024, 16:08
https://www.advitamdistribution.com...
13/04/2024, 12:45
Avec grand plaisir. :) (Cheminement intéressant !)
05/04/2024, 10:15
Salut Renaud ! Waouw tu t'es adonné à un sacré travail d'archéologie en…
05/04/2024, 09:49
Travail archéologique #2. :) (qui a l'avantage de me replonger dans certaines…
04/04/2024, 19:47
Salut Nicolas ! Waouw tu t'es adonné à un sacré travail d'archéologie en faisant…
04/04/2024, 19:40